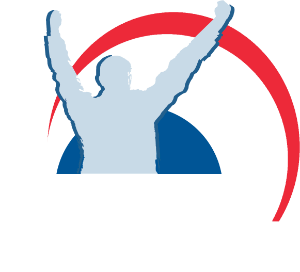Article inédit écrit en 1971 et publié dans Espoir n° 24, 1978
Chez ceux qui pensent que le général de Gaulle, malgré l’œuvre immense accomplie, n’a pas eu le temps nécessaire à l’achèvement de son destin et de ses entreprises, un regret prédomine : qu’il ne se soit pas penché plus tôt, qu’il ne se soit pas donné plus qu’il ne l’a fait aux problèmes de l’Asie.
Qu’il ait été conscient des immenses potentialités asiatiques, certes. Comment un esprit universel, tel que le sien, ne l’eût-il pas été ? S’il n’avait pas servi en Extrême-Orient comme tant de nos grands soldats (Lyautey, Joffre, etc.), s’il n’en avait pas subi l’ineffaçable empreinte, il sentait pourtant, d’instinct, l’écrasante présence de ce continent à sa mesure. Comme la plupart des grands hommes de l’Histoire (Alexandre, Napoléon…) il était fasciné par l’Orient. Qu’on relise le morceau d’anthologie qu’il a consacré à la Chine dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964.
Dès Brazzaville, de Gaulle s’était préoccupé du devenir de notre empire et son fameux discours d’alors, généreux, novateur, pour certains révolutionnaire, révèle une extraordinaire prescience.
Mais, en ce qui concernait l’Indochine, il restait en deçà et arrivait trop tard. Quinze jours plus tôt, les Japonais avaient porté un coup décisif à notre prestige en s’installant en maîtres dans la péninsule indochinoise. Combien de nos compatriotes, en France occupée ou dans la France libre, perçurent l’importance de l’événement et ses conséquences prévisibles ?
De Gaulle comprenait qu’il fallait pourtant s’essayer à la décolonisation (il la sentait inéluctable) et que c’est en Indochine qu’elle devrait trouver sa première application. Il savait que de tous nos protégés d’outremer les Indochinois s’étaient révélés les meilleurs élèves, « majeurs », les plus dignes de l’autonomie. Il était résolu à aller de l’avant. Mais il connaissait d’autre part les appétits et les projets plus ou moins avoués et plus ou moins désintéressés de certains de nos alliés.
Les grandes lignes de son plan semblent donc avoir été les suivantes :
- faire d’abord valoir les droits de la France en Indochine
- après l’avoir rétablie dans ses droits, aménager nos positions, en accord avec nos protégés de la veille, appelés à devenir nos associés du lendemain (Union française, Communauté…)
Pour parvenir à cela, le Général avait compris qu’il fallait avant tout participer à la lutte contre le Japon, seul allié de l’Axe encore debout, afin d’être présents à la victoire en Asie (comme nous l’avions été, grâce à lui, à la victoire en Europe). C’était la condition nécessaire pour que nous fussions habilités à faire valoir nos droits. Ce qui suscita la mise sur pied d’unités d’intervention (brigade de Madagascar, brigade du Cameroun, corps léger d’Intervention du général Blaizot, etc.). Mais les préparatifs ne purent être poussés assez rapidement et le gouvernement fut pris de court par les événements des 6 et 9 août 1945, à savoir l’anéantissement de Hiroshima et de Nagasaki par les premières bombes atomiques américaines. Nos alliés chinois, chargés de désarmer les Japonais au Tonkin, s’y comportèrent comme d’autres occupants et, dans la confusion qui s’ensuivit, les mouvements révolutionnaires vietnamiens prirent le pouvoir.
S’ajoutait à cela la mauvaise volonté des Alliés, qui se montraient réticents à fournir le shipping nécessaire pour transporter à pied d’œuvre les unités constituées. Seules étaient prêtes et déjà en place les antennes de la Section de liaison française d’Extrême-Orient, à Calcutta en Inde, et à Kunming en Chine.
Sur le plan politique, le général de Gaulle, pour donner un aspect plus libéral au protectorat français, envisageait de substituer à Bao Dai sur le trône d’Annam le prince Vinh Sanh, qui avait participé aux combats pour la libération de la métropole. Projet peu connu et qui malheureusement avorta, Vinh Sanh ayant trouvé la mort dans une catastrophe aérienne à Noël 1945.
Quand j’eus réussi à signer avec Hô Chi Minh les accords de mars 1946, de Gaulle fut d’abord réticent, ne se montra pas enclin à recevoir Hô en France (influence de l’amiral d’Argenlieu). Mais, avec le temps, il se rendit compte que Hô restait la seule autorité valable au Vietnam, qu’avec lui la France aurait dû, devait établir de nouveaux rapports.
On sait les positions qu’il prit à propos de la guerre américano-vietnamienne après son retour au pouvoir. Les États-Unis s’enlisaient dans le conflit, le prestige de Hô Chi Minh grandissait de jour en jour, mais aucun chef d’État occidental n’avait osé prendre parti contre les Américains.
Avant d’aller au Cambodge pour y prononcer son fameux discours de Pnom-Penh, le Général m’envoya en Extrême-Orient et particulièrement à Hanoi, me chargeant d’une lettre chaleureuse pour Hô Chi Minh (1). Celui-ci me remit en réponse une lettre non moins chaleureuse. C’est à la demande expresse du Général qu’elles furent, l’une et l’autre, lues à la radio et à la télévision.
Il n’est pas douteux que de Gaulle, après sa retraite, projetait de se rendre en Chine à l’invitation du gouvernement de la République populaire, qui l’aurait accueilli avec autant de déférence que d’enthousiasme…
J.S. (1971)