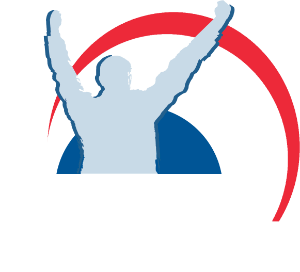Académie des Sciences morales et politiques, le 15 octobre 2025.
En juin 1940, le jeune Yves Guéna – il n’a pas dix-huit ans – s’embarque pour l’Angleterre. Fraichement débarqué, affamé, il s’engouffre dans un Pub pour étancher sa soif et sa faim d’un sandwich et d’une bière. Mais il n’a pas de quoi payer, lui qui a tout quitté, cœur vaillant et poches vides. Le tavernier l’entend bredouiller les quelques mots d’anglais qu’il maitrise alors. Et de s’exclamer, d’un cri du cœur : « Free french ? Be my guest ! ».
Il y eut bien une épiphanie de cette sorte-là entre De Gaulle, « trop seul et trop pauvre pour céder quoi que ce soit », et Churchill, à qui s’applique cette célèbre maxime gaullienne selon laquelle « pour être grand, il faut épouser une grande querelle ». Il y a dans l’attitude du Churchill de l’été 1940 comme dans sa personnalité une générosité profonde, sincère, que l’on n’attribue pas forcément très spontanément au tempérament britannique, à tort : il faut connaitre cet engagement de 1940, cette acceptation placide du combat, des souffrances, des bombardements, tant que l’on donne à John Bull les moyens de se battre.
Churchill en est l’incarnation. De Gaulle pressent sans doute la personnalité de ce vieux lutteur, qui au fond ne respire bien que dans la tempête, après tant d’années de purgatoire à la Chambre des Communes, à hurler contre l’indifférence cynique et sentencieuse. Cette personnalité de l’homme de caractère, De Gaulle l’a dépeinte par anticipation huit ans plus tôt dans Le Fil de l’épée : « Mais que les évènements deviennent graves, le péril pressant, que le salut commun exige tout à coup le goût du risque, la solidité, aussitôt, change la perspective et la justice se fait jour. Une sorte de lame de fond pousse au premier plan l’homme de caractère. On prend son conseil, on loue son talent, on s’en remet à sa valeur ».
Trois moments me semblent symboliser cette relation entre l’homme de Blenheim et celui de Colombey-les-Deux-Églises.
Le premier nous ramène aux premiers temps du conflit, le 28 juin 1940, quand seuls De Gaulle, guidé par sa vision, et Churchill, porté par sa volonté, envisagent la possible défaite allemande. De Gaulle est alors un homme seul. « Qu’importe », rétorque Churchill, « vous êtes seul, je vous reconnais tout seul ». C’est ce qui les relie : ils sont leur pays, ils sont les seuls dépositaires de leur part irréfragable de souveraineté nationale qui survit aux coups de boutoir de l’armée allemande. Peut-être sont-ils même encore davantage : Churchill plus que l’Angleterre dont une partie des élites cherche à transiger, De Gaulle plus que les Français dont une large majorité accepte la défaite. On pense à ces lignes admirables d’Albert Cohen : « Ils les font ce qu’ils sont. Ils les haussent jusqu’à eux-mêmes » Combien existe-t-il de moments où un homme est son pays ? Qui, au fond, peut en dire autant dans l’histoire contemporaine de deux nations ?
Le second moment nous conduit au 11 novembre 1944. Churchill participe au défilé militaire sur les Champs-Élysées, en invité d’honneur, alors que la guerre fait encore rage en Lorraine, dans les Vosges et en Alsace. On sait combien la victoire de 1918 a creusé un fossé entre la France et l’Angleterre : la présence ce jour-ci de Churchill, premier ministre et chef de guerre, est une transgression inouïe. Elle est un signe de réconciliation, d’amitié comme, là encore, par-delà les brouilles et les conflits, seuls deux géants peuvent en prodiguer. Sur les images d’archives, regardons Churchill, saisi par l’émotion, saluant la foule de son chapeau, presque maladroitement, saluant un peuple qu’il aime, et auquel tant d’histoire le lie. C’est à Paris que ses parents se sont mariés. C’est sur les champs de bataille français qu’il a donné les derniers feux de sa carrière militaire. C’est enfin sur le sol français, de Briare à Tours, que se noue son grand destin. Churchill aime la France, alors qu’une grande partie des élites anglaises la méprisent, ou la dénigrent. On sent aussi cette tendresse dans l’incipit de son discours de Strasbourg en 1949 : « Préparez-vous, je vais parler en français : une entreprise terrifiante, et qui sera une dure épreuve pour votre amitié envers la Grande-Bretagne. » On peut lire la sincérité de cet attachement sur son visage, cette émotion presque enfantine, qui lui ouvrira, pour lui seul, l’ordre des Compagnons de la Libération, le 6 novembre 1958, avec ces mots du Général : « La France sait ce qu’elle lui doit ».
« Je regretterais de vivre dans un pays gouverné par de Gaulle, mais regretterais aussi de vivre dans un monde, ou avec une France qui n’aurait pas un De Gaulle », écrivait Churchill en 1949. Cette ambivalence de deux géants luttant férocement pour la souveraineté de leur pays, mais comprenant que l’un grandissait l’autre, est ici mise à nu. Ce sentiment est aussi celui du Général. La dernière image nous amène en janvier 1965, au moment où le décès de Churchill clôt ce parcours partagé, alors que les grues du port de Londres saluent le passage de son cercueil sur la Tamise. Les mots adressés à la reine Elizabeth sont sobres, mais denses : « La France ressent profondément le deuil qui frappe l’Angleterre. Pour tous, dans mon pays, pour moi-même, Sir Winston Churchill est et restera toujours celui qui, en dirigeant jusqu’à la victoire l’admirable effort de guerre britannique, contribua puissamment au salut du peuple français et de la liberté du monde. Dans ce grand drame il fut le plus grand ». Aux obsèques dans le froid londonien, le 31 janvier 1965, De Gaulle est en uniforme, l’air absent. Peut-être pressent-il que, pour lui aussi, le dernier acte approche. Le chemin est loin d’être fini, mais il hésitera, quelques mois plus tard, à solliciter des français un second mandat présidentiel : soit qu’il redoute, comme Churchill, de se heurter à l’ingratitude des peuples en paix, soit qu’il considère, comme il est possible, que le temps qui reste est désormais à l’histoire et aux Mémoires.
Pour imaginer ce que pouvait représenter Churchill pour de Gaulle, comment ne pas penser à cette formule employée au sujet de Malraux, « ami fervent des hautes destinées », aventurier du quotidien, enfermé et étouffant dans une réalité trop morne, et ne respirant qu’au vent de la grande histoire ? De Gaulle ne sera pas que l’homme des tempêtes. Car à la différence de Churchill, il sera aussi l’homme de la refondation, tant pour lui la crise et la vision de long terme se répondent sans s’opposer, comme si l’une fécondait l’autre. Mais si la France « sait ce qu’elle doit à l’Angleterre », c’est, comme l’écrivait Albert Cohen, « d’avoir eu la force de tenir périlleusement le solitaire flambeau de liberté et d’espoir sur l’Europe ». N’oublions jamais la conclusion d’Albert Cohen : « Sans l’Angleterre, et son âme qui est Churchill, le monde des hommes humains était mort ».
Propos de M. Hervé GAYMARD