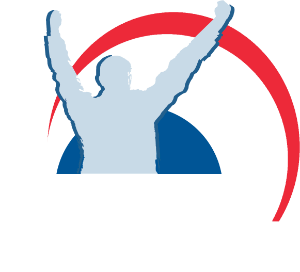DE L’APPEL AUX MÉMOIRES D’ESPOIR 
Témoignage de Philippe de Gaulle recueilli par Jacqueline Baudrier
Cet entretien a été réalisé le 18 juin 1971 dans le cadre de l’émission « 24 heures sur la 2 ». Disparue le 2 avril 2009, Jacqueline Baudrier était alors directrice de l’Information de la deuxième chaîne de télévision. Nous remercions l’amiral de Gaulle de nous en avoir communiqué la transcription, inédite jusqu’à aujourd’hui, et de nous avoir autorisés à la publier. Espoir, n°157, juin 2009

Le 8 janvier 1943, le général de Gaulle inspecte les établissements et les bâtiments des Forces navales de la France Combattante à Dundee. Parmi les marins, son fils Philippe.
Jacqueline Baudrier : Commandant Philippe de Gaulle, en cette journée du 18 juin, le souvenir du général de Gaulle est dans bien des esprits. Mais quand il s’agit de Charles de Gaulle, vous n’êtes pas tout à fait un Français comme les autres puisque vous êtes son fils, et ce que je voudrais savoir c’est comment vous ressentez le 18 juin ?
Philippe de Gaulle : Je le ressens d’abord sur des souvenirs personnels : ce qu’ont été tous les 18 juin depuis le premier, les 18 juin de la guerre, le 18 juin 1940, durant lequel, avec ma famille, ma mère et mes deux sœurs et une autre personne, nous avons pris un trans-Manche de Brest pour nous rendre en Grande-Bretagne, à Falmouth. C’est un trajet qui s’est fait avec une relative facilité matérielle, encore que nous n’avions que les vêtements que nous portions sur le dos. Cependant, il faut voir que c’était le franchissement d’une étape très importante moralement et très difficile ; il fallait tout quitter et se lancer dans un domaine et dans une période où nous ne savions pas du tout ce qui allait se produire. Cela dit, nous n’imaginions pas une seconde que l’Empire français et ce qui restait de l’armée française en Grande-Bretagne n’auraient pas continué la lutte ; nous pensions que l’Angleterre n’était qu’une étape vers une autre, en attendant la Libération, d’autres combats.
Il y avait beaucoup de monde en Grande-Bretagne, mais peu sont restés avec nous : aussi la plupart de ceux qui étaient avec moi, que j’ai retrouvé ensuite, étaient, comme les gens de l’île de Sein, ceux qui sont venus de l’extérieur.
J.B. : Est-ce que vous aviez eu connaissance de l’Appel ?
Ph. de G. : Nous n’avons eu aucune connaissance de l’Appel. Nous ne l’avons pas entendu. Nous avons eu connaissance de la présence de mon père en Grande- Bretagne par les journaux, en arrivant, le lendemain.
J.B. : Quand vous avez pris connaissance de l’Appel du général de Gaulle, quel sentiment avez-vous éprouvé ? Etait-ce de la surprise ?
Ph. de G. : Non, ça ne m’a pas du tout étonné. Comme je vous l’ai dit, on ne pensait pas une seconde que la France allait cesser le combat. Mon père était allé en Grande-Bretagne pour régler des questions relatives à des évacuations de troupes ; nous avions beaucoup de monde en Grande-Bretagne, 140 000 hommes, de la Marine et aussi du Corps expéditionnaire de Norvège. Nous pensions que le combat allait continuer, en France pour certaines évacuations puis, ensuite, à partir de nos possessions de l’Empire. Cela faisait partie de sa tâche, depuis la Grande- Bretagne, de susciter les moyens de défense qui nous restaient encore.
J.B. : Vous aviez 18 ans à l’époque. Qu’avez-vous fait en arrivant à Londres ?
Ph. de G. : Je me suis retrouvé, très peu de temps après mon arrivée, en civil, à bord d’un vieux cuirassé qui s’appelait Le Courbet, qui était à Porsmouth et qui faisait de la défense aérienne. J’étais derrière une pièce de 75 tirant sur les avions allemands dont on peut dire qu’à l’époque, ils couvraient tout l’horizon. Il y avait des centaines d’avions à tel point que celui qui était chargé de désigner l’objectif en bafouillait, n’arrivait plus à désigner cet objectif. Le sentiment, c’était une joie féroce de pouvoir tirer sur les Allemands.
J.B. : Avez-vous rencontré souvent votre père durant cette période de la guerre ?
Ph. de G. : Non, assez peu ; une ou deux fois par an. Par exemple, je ne suis jamais allé à Alger. Je suis resté en Grande-Bretagne, dans la mer du Nord et dans l’Atlantique-Nord où nous opérions.
Je me souviens, en tout cas, d’une date particulière où nous avons dîné ensemble : c’était la veille du débarquement allié du 6 juin 1944. Nous avons dîné en tête-à-tête puis, vers onze heures-minuit, il m’a dit : « Ça y est » – « Ça y est quoi ? » – « Eh bien, les parachutistes du débarquement en France viennent de sauter et le débarquement a commencé ».
J.B. : Est-ce que vous aviez le sentiment qu’il avait toujours gardé cette confiance qui transparaissait dans l’Appel, cette espérance, ou l’avez- vous vu découragé et pessimiste ?
Ph. de G. : Je ne vous étonnerai pas en vous disant que la nature de l’homme était que l’espoir l’habitait toujours, en particulier en ce qui concernait les Français, et dans ce cas précis cette guerre de 1939-1945.
J.B. : Il a toujours exprimé cette confiance ?
Ph. de G. : Il a aussi pensé qu’il n’y avait pas d’autre solution que de mettre les Allemands hors de France par la force.
Dans le fond, il n’a jamais été découragé, bien qu’à certaines périodes, la situation était, en ce qui nous concernait, redoutable : j’évoque le cas du débarquement en Afrique du Nord d’où nous avions été écartés : le fait qu’on ne savait pas très bien comment la Grande-Bretagne pourrait se sortir d’un combat où elle était seule : le débarquement en France… Mais, dès le départ, son évaluation était que, mathématiquement, les Allemands ne pouvaient pas gagner. D’ailleurs, cette évaluation recoupait ce qu’Hitler avait dit à ses familiers et qui ressort des archives du procès de Nuremberg, que lorsque la France et la Grande-Bretagne sont entrées en guerre pour l’affaire de la Pologne, il en avait été désespéré et avait pensé que l’Allemagne n’aurait pas les forces humaines nécessaires pour résister à la coalition qui se dresserait contre elle, une coalition mondiale.
J.B. : Quel est pour vous et quel a été pour lui, le 18 juin le plus émouvant ?
Ph. de G. : Je crois que cela a été le 18 juin 1945, celui de la Victoire. En effet, la date administrative de la fin de la guerre en Europe est le 8 mai, mais c’est une date administrative, tandis que le 18 juin, c’était celle de la Victoire. C’est ainsi que nous le voyions. C’était, toute proportion gardée, exactement ce que le 11 novembre 1918 représentait pour mon père et pour nous aussi, qui étions ses compagnons de combat, c’est-à-dire le jour où on fête la victoire et où on honore les morts. C’est ainsi qu’il voulait toujours considérer le 18 juin et tous les 18 juin depuis ce magnifique défilé de la Victoire du 18 juin 1945, celle de tous les Français puisque tous avalent fini par participer à cette victoire, mais spécialement notre Victoire à nous Français libres et sa Victoire à lui.
J.B. : On avait dit à un moment donné qu’il aimerait reposer dans la crypte du Mont Valérien ?
Ph. de G. : Il n’y a jamais pensé. Il y a effectivement dans cette crypte seize cercueils, dont l’un, qui est vide, est réservé au dernier survivant des Compagnons de la Libération.
J.B. : Comment expliquez-vous que depuis son départ des affaires, depuis le 27 avril 1969, il ne soit plus venu s’associer aux cérémonies du Mont Valérien, alors que pour tous les Français, cette journée du 18 juin est vraiment la journée du général de Gaulle ?
Ph. de G. : Le général de Gaulle estimait qu’il était politiquement mort le 27 avril 1969, que par conséquent, il était entré dans un autre chapitre et qu’il n’avait plus à figurer dans la vie courante des Français.
J.B. : Je crois que pour l’Histoire, le général de Gaulle restera d’abord et avant tout l’Homme du 18 juin. Est-ce que vous pensez qu’il aurait adhéré à ce jugement ?
Ph. de G. : Je ne le pense pas. Si comme je l’ai dit, le défilé de la Victoire a été l’aboutissement du 18 juin, ce n’est qu’une très petite partie de ces trois décennies dont il a été un des éléments essentiels, qu’il soit présent ou absent des affaires publiques. Il n’y a pas de discontinuité dans cette trame, le 18 juin n’est qu’un début. Il a été aussi le Rénovateur de la République. La plus grande partie de son œuvre est postérieure à ces années de guerre.
J.B. : Comment s’établissaient vos relations avec votre père. Etait-il un père sévère ?
Ph. de G. : On ne peut pas dire qu’il était un père sévère. C’était un père exigeant bien sûr, comme il l’était pour lui-même. Il était surtout très impressionnant.
J.B. : Etiez-vous intimidé en sa présence ?
Ph. de G. : J’étais intimidé comme bien d’autres qui ont aujourd’hui un poste très élevé. J’étais surtout intimidé beaucoup plus jeune. Au fur et à mesure que l’âge m’est venu, je l’étais moins, j’étais beaucoup plus libre.
J.B. : Est-ce qu’il vous parlait des grandes affaires ?
Ph. de G. : Souvent. Oui, souvent.
J.B. : Est-ce que vous étiez toujours d’accord avec lui ?
Ph. de G. : Sur le fond, toujours. Son argumentation était toujours irréfutable. Il jugeait très bien les choses et les gens. Sur les modalités, disons de détails, évidemment, nous n’avions pas le même âge et nous n’étions pas de la même génération.
J.B. : Quand vous n’étiez pas d’accord avec lui, vous le lui disiez ?
Ph. de G. : Ah ! absolument.
J.B. : Et comment réagissait-il ?
Ph. de G. : Il admettait très bien qu’on ne soit pas d’accord avec lui. Mais il expliquait en quoi il était obligé car, en fait, la solution choisie est le résultat de bien des obligations et de bien des appréciations, ce n’est pas celle que quelquefois, de cœur, on préférerait.
J.B. : Est-ce très difficile d’être le fils de Charles de Gaulle ?
Ph. de G. : Au début, j’ai trouvé cela assez difficile.
J. B. : Pourquoi ?
Ph. de G. : Pour un enfant ou un jeune homme, vivre dans l’ombre d’une personnalité aussi marquante, ça n’est pas très commode.
J.B. : Pour le développement de votre personnalité ?
Ph. de G. : Exactement, car là, on est obligé à une réserve, je dirai presque exagérée. C’est ainsi que personne n’a jamais entendu parler de ce que j’avais pu faire pendant la guerre. Je crois vraiment qu’il n’y a pas de fils de chef d’Etat depuis fort longtemps, en France et à l’étranger qui se soit battu autant que moi et qui ait couru autant de risques par la suite. Mais la réserve et cette espèce de pudeur égalitaire, pathologique des Français imposaient que je reste complétement dans l’ombre. C’est certainement une entrave à l’épanouissement d’une personnalité.
Ce dont je m’aperçois, c’est que si moi je me suis, à la longue, habitué à être le fils du général de Gaulle, je ne suis pas toujours sûr que mes interlocuteurs, eux, en aient pris l’habitude.
En monarchie, vous avez sans doute remarqué qu’on s’efforce de trouver toutes sortes de qualités aux fils des personnalités importantes, tandis qu’en République, on a plutôt tendance à ne leur trouver que des défauts.
J.B. : Est-ce que vous avez le sentiment que le général de Gaulle appartient à sa famille ?
Ph. de G. : Ah ! Absolument. Le général de Gaulle est le produit de sa famille. Il est le produit d’un certain milieu, d’une éducation, d’une chaîne biologique et de nombreuses générations. C’est une erreur de croire qu’un individu apparaît avec soi-même. C’est une négation biologique. Et il vivait dans un contexte dont nous faisions partie, auquel il tenait.
J.B. : Seulement, comme tous les personnages historiques, il appartient à tout le monde également.
Ph. de G. : Il appartient à tout le monde, mais spécialement à nous. Et sa vie privée, ça a toujours été la nôtre, celle qui nous a permis vraiment de le connaître, on peut le dire. Car je me suis aperçu qu’en réalité, on le présentait toujours comme un personnage très différent de ce qu’il était. Et je soupçonne qu’il en est ainsi de beaucoup de personnages historiques.
J.B. : En quoi était-il différent à vos yeux ?
Ph. de G. : Par exemple, certains ouvrages ou articles lui attribuent un langage militaire. Or, dans ces ouvrages, j’ai souvent constaté que les propos militaires « entre guillemets » qu’on pouvait lui attribuer, je n’en avais jamais entendu autant de toute ma vie que dans les quelques épisodes qui étaient évoqués. En réalité, ce langage militaire était la transposition, en langage de cabinet ou d’aide de camp, des propos qu’il pouvait tenir autrement.
J.B. : On le présentait aussi beaucoup comme une idée en marche, un monument historique. On a même dit, c’est André Malraux je crois, qui a dit un jour : « Il n’y a pas de Charles ». Or, vous, vous connaissiez Charles ?
Ph. de G. : Je connaissais Charles ; il y en avait certainement un. C’était un homme très sensible qui, en dehors du personnage officiel qu’on représentait, de l’attitude dans laquelle il était obligé d’être, de tenir, était tout de même quelqu’un qui avait une sensibilité extrêmement aigue et qui voyait très bien tous les problèmes, même les plus humbles.
J.B. : Ce qu’on a appelé l’intendance. On a dit que le général de Gaulle avait eu cette phrase…
Ph. de G. : Les problèmes des Français.
J.B. : Oui, qu’il aimait mieux la France que les Français.
Ph. de G. : Non. Quand il disait la France, il pensait à la nation française qui a été, en réalité, sa seule passion. C’est-à-dire qu’il ne pensait pas que les Français avaient une chance de survivre en tant qu’individus ; il pensait que leur meilleure chance était en tant que Nation, avec tout ce que cela comportait, en particulier le lien qu’il faisait entre la grandeur et la prospérité qui étaient, pour lui, absolument indissociables. Quand on fait un contrat commercial avec un pays étranger, les atouts que l’on présente sont complètement différents, bien qu’ils soient de nature strictement commerciale, s’il s’agit d’un pays qui arrive avec, derrière lui, une opinion décidée, une armée très considérable ; on s’aperçoit que même quand il s’agit de voitures, de produits divers, manufacturés ou autres, c’est la nation puissante qui a les meilleurs atouts de discussion.
J.B. : Il parle d’ailleurs beaucoup de ces problèmes dans le deuxième tome des Mémoires d’espoir, le tome inachevé [1].
Ph. de G. : Je suis très surpris d’avoir constaté le peu de commentaires qui ont été faits sur le contenu réel de ce deuxième tome. Il a été présenté comme quelques passages poétiques, suivis de portraits de personnalités politiques, alors qu’il y a beaucoup d’autres choses. Il est question, en fait, de tous les problèmes qui devaient préoccuper toute la période qui a suivi son élection présidentielle : c’est- à-dire qu’il est question des autoroutes, des produits agricoles, du canal de la Marne au Rhin, des mines et des mineurs, de la prolongation de la scolarité de 14 à 16 ans, des problèmes d’orientation et de sélection, tout cela dans un contexte de crise de civilisation, de passage à la civilisation industrielle qu’il a d’ailleurs très bien évoqué à mon avis.
- B. : C’est le malaise des âmes? [2]
Ph. de G. : Je cite le passage : « Par rapport à l’existence individualiste de ruraux, d’artisans, de commerçants, de rentiers qui, depuis tant de siècles avait été celle de nos pères, les Français d’aujourd’hui se voient contraints, non sans quelque peine, à une vie mécanisée et agglomérée. Aux usines, ateliers, chantiers, magasins, le travail exige des gestes uniformément réglés, dans d’immuables engrenages, avec les mêmes compagnons. Repas rationnellement distribués dans les cantines. Acclamations à l’unisson dans les enceintes des stades sportifs. Congés qui se passent sur des sites encombrés, parmi les visiteurs, campeurs, baigneurs alignés. Détente du jour et de la nuit chronométrée pour les familles dans d’homothétiques appartements où toutes, avant de s’endormir, voient et entendent simultanément les mêmes émissions, des mêmes ondes. Il s’agit là d’une force des choses dont je sais qu’elle est pesante à notre peuple plus qu’à aucun autre en raison de sa nature et de ses antécédents, et dont je sens que, par une addition soudaine d’irritations, elle risque de le jeter un jour dans quelque crise irraisonnée ».
J.B. : Il vous en parlait souvent de cette inquiétude concernant une crise grave de la jeunesse ou de la civilisation ?
Ph. de G. : Il en parlait, oui, en ce sens qu’il n’ignorait pas que les transformations historiques de la société s’accompagnaient de troubles divers. Déjà, avant-guerre, il avait évoqué certaines caractéristiques des Français, qui se retrouvent dans ce qu’on vient de lire, dans un livre qui s’appelait Vers l’armée de métier, qui a été écrit en 1934 et dans lequel il dit : « Ce Français qui met dans son esprit tant d’ordre et si peu dans ces actes, ce logicien qui doute de tout, ce laborieux nonchalant, ce casanier qui colonise, ce fervent d’alexandrins, de l’habit à queue, du jardin royal, ce Colbert collègue de Louvois, ce Jacobin qui crie : « Vive l’Empereur », ce politicien qui fait l’Union sacrée, ce battu de Charleroi qui donne l’assaut sur la Marne, bref, ce peuple mobile, incertain, contradictoire.. ». C’est mai 1968.
J.B. : Oui, et c’était écrit 34 ans avant.
Ph. de G. : C’était écrit 34 ans avant. C’est bien ce qu’il a analysé dans ce deuxième tome des Mémoires d’espoir, et cela se retrouve d’ailleurs dans toute son œuvre, ce côté contradictoire des Français, à la fois logiques et irraisonnés.
J.B. : Vous n’ignorez pas qu’à propos de ce deuxième tome inachevé des Mémoires d’espoir, certains ont dit que, peut-être, il n’aurait pas fallu le publier parce qu’il ne formait pas un tout. Alors pourquoi avez-vous pris, vous, cette décision ? Pour quelles raisons profondes ?
Ph. de G. : Nous étions certains qu’il fallait le publier. Tel était son désir, et d’ailleurs ces chapitres étaient absolument terminés, donc publiables comme tels. Il est très regrettable qu’il n’ait pas pu écrire les suivants mais ce qui était en état d’être publié, je crois qu’il était important que cela l’ait été, le plus vite possible et sans autres considérations.
J.B. : On s’est interrogé aussi sur la question de savoir si le dernier chapitre du troisième tome « Le Terme » n’avait pas été rédigé par le Général comme une sorte de testament politique ? [3]
Ph. de G. : Non, pas du tout. Il avait un plan très général sous la forme d’un schéma : il rédigeait les chapitres les uns après les autres, en sériant les problèmes. Il y avait un chapitre qui eut été le dernier s’il avait pu l’écrire et dont il parlait.
J.B. : Et vous savez ce qu’il y avait dans ce chapitre ?
Ph. de G. : Il se faisait une joie de pouvoir écrire ce chapitre. Il aurait évoqué les personnages historiques tels que Colbert, Richelieu ou Clemenceau et il leur aurait demandé : « Dans la situation que j’avais, qu’est-ce que vous auriez fait, vous ? Qu’est-ce que vous auriez fait, vous. Clemenceau, qui aviez une France unanime, qui s’est portée aux frontières d’un seul homme, qui était première puissance mondiale, qui avait de l’or ? Qu’est-ce que vous auriez fait, vous, Clemenceau, à ma place ? »
J.B. : Dans les Mémoires de guerre, il y a une phrase par laquelle le général de Gaulle exprime un espoir. Il dit : « Ce que j’ai fait sera, tôt ou tard, la source d’ardeurs nouvelles après que j’aurai disparu ». A votre avis, qu’aurait-il aimé voir se prolonger de cet héritage, qui soit la source d’ardeurs nouvelles ?
Ph. de G. : Je crois que la leçon d’ensemble des écrits du général de Gaulle est qu’un peuple, une nation doit avoir une ambition nationale, des ambitions nationales et que la prospérité ne se sépare pas de la grandeur, qu’il faut avoir de grands desseins, se dépasser soi-même. Il faut avoir des « locomotives ». Ne pas fabriquer le Concorde, c’est renoncer à une industrie aéronautique. Et renoncer à une industrie aéronautique, c’est très rapidement tomber à la fabrication des casseroles, c’est- à-dire l’abandon du niveau de vie. Et cette grandeur est indissociable de la prospérité.
J.B. : Commandant Philippe de Gaulle, pendant toute cette conversation, j’ai eu le sentiment que vous vouliez bien faire comprendre l’action de votre père. Vous avez peut-être l’impression que son souvenir, sa mémoire, ne sont pas toujours présentés comme vous le souhaiteriez.
Ph. de G. : Ah! bien sûr. Je vois quotidiennement des écrits ou des articles qui sont très éloignés de ce que je sais et de ce dont j’ai été témoin. Et malgré la très grande habitude que j’en ai, car je ne suis jamais entré dans un compartiment de métro sans voir quelqu’un lire quelque chose sur le général de Gaulle, d’obligeant ou de très désobligeant, malgré la très grande habitude que j’en ai, il me chagrine parfois de voir de quelle manière il est présenté.
J.B. : Et vous, vous le regardez avec vos yeux de fils, c’est-à -dire que votre regard ne peut pas être complètement, disons, objectif.
Ph. de G. : Mon regard est objectif en ce sens que, d’abord, je l’ai connu mieux que beaucoup, et peut-être même que personne. Mais il ne faut pas séparer un homme des événements, d’un contexte, et moi, je faisais partie de ce contexte et je l’ai vu aussi dans ce contexte. Et je crois que c’est une erreur des historiens, qui leur est très commode, de schématiser à l’excès un certain nombre d’événements historiques ou de personnages, ce qui est peut-être plus facile pour la compréhension, pour les thèses qu’ils veulent en produire, mais qui n’est pas exact. Le général de Gaulle est incompréhensible s’il est sorti de son contexte familial et personnel. Celui-là, je le connais et j’ai pu constater que, malheureusement, très très peu d’écrits même bien intentionnés – que dire de ceux qui sont mal intentionnés – transposent exactement ce qu’il était vraiment.
J.B. : En cette journée du 18 juin, je crois que l’on ne peut s’empêcher de réfléchir à ce qu’a été le côté extraordinaire du destin historique du général de Gaulle. Quel jugement portez-vous, vous-même, sur ce destin ?
Ph. de G. : Une des caractéristiques de ce destin, à mon avis, c’est que le général de Gaulle a dû constamment faire face à l’adversité, constamment contrer la mauvaise chance. Et moi je crois qu’on ne l’a finalement apprécié que dans des situations difficiles et quand il a eu affaire à des difficultés. Dès que les choses ont été bien, les gens se sont détournés de lui, plus ou moins.
J.B. : Est-ce qu’il en souffrait ?
Ph. de G. : Il avait trop d’expérience de la vie publique pour savoir que ce sont des choses qui se produisent et il n’en était point étonné. Je ne veux pas dire qu’il ne le ressentait pas. Mais l’un de mes regrets c’est que mon père n’ait pas pu terminer ses œuvres dans lesquelles, selon ses propres termes, il escomptait indiquer « ce qu’il avait fait, ce qu’il était et ce qu’il aurait voulu faire ».
[1] Le second tome des « Mémoires d’Espoir » avait paru en février 1971.
[2] Jacqueline Baudrier fait sans doute allusion à ce passage du début du chapitre 2 de L’Effort : Sans doute, le malaise des âmes qui résulte d’une civilisation dominée par la matière ne saurait-il être guéri par quelque régie que ce soit. Tout au moins pourrait-il être un jour adouci par un changement de condition morale qui fasse de l’homme un responsable au lieu d’être un instrument. (Mémoires d’espoir, I, p. 122-123)
[3] Les « Mémoires d’espoir » devaient comprendre trois tomes. Le général de Gaulle avait donné comme titre au troisième : « Le Terme, 1966-1969 »