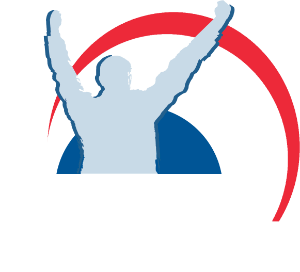EVELYN OUDINOT
Le sourire de Solférino
Par Éric Branca
En ce temps où le soleil n’entrait encore que parcimonieusement dans le vestibule du 5, rue de Solferino – une cloison supprimée et tout vient de changer ! – c’est du premier étage que descendait la lumière. Et pour les jeunes visiteurs intimidés par la solennité du lieu, cette lumière rassurante portait un nom : Evelyn Oudinot. Je n’avais pas dix-neuf ans quand, en janvier ou février 1977, elle vint accueillir jusqu’au rez-de-chaussée l’élève d’hypokhâgne que j’étais. Je venais pour la première fois à l’Institut Charles de Gaulle. Fantômes et vivants s’y bousculaient. Son premier président, André Malraux, était mort quelques mois plus tôt, mais son successeur, Gaston Palewski, y passait régulièrement, tout comme Geoffroy de Courcel, son vice-président, la « maison » étant tenue d’une main aussi ferme que bienveillante par son créateur, Pierre Lefranc, qui en restera le secrétaire général jusqu’à sa transformation en Fondation, en 1992.
C’est dire si les étudiants se sentaient modestes quand ils croisaient dans l’escalier ces trois personnages d’épopée, familiers du Général depuis la France libre… Sans parler de tous ceux, anciens ministres ou collaborateurs, conviés aux tables rondes que l’Institut organisait alors pour faire profiter historiens et chercheurs en Sciences politiques d’une confrontation, parfois vive mais toujours fructueuse, avec tant d’acteurs vivants, pour la plupart encore dans la force de l’âge.
Si, dans cette première décennie « sans de Gaulle », une greffe put s’opérer entre ceux qui l’avaient servi et une nouvelle génération désireuse de capter l’héritage à sa source, c’est grâce, très largement, au rayonnement personnel d’Evelyn, dont le charme, la gaîté et l’enthousiasme n’avaient d’égal que sa capacité à faire s’accorder les êtres en abolissant les barrières du temps.
Née à Hambourg en 1919, d’un père français, diplomate, et d’une mère norvégienne (d’où Evelyn sans ‘‘e’’), elle fut l’hôtesse de l’air personnelle du Général pendant toute la période élyséenne avant de rejoindre l’Institut en 1972, un an après sa création, puis de prendre en charge, à partir de 1974, ses relations extérieures. Jusqu’à son départ à la retraite, dix ans plus tard, elle fit de ce poste un véritable bureau de recrutement. Dire que des centaines d’étudiants ou de jeunes actifs sont venus étoffer, grâce à elle, les rangs des Amis de l’Institut n’est pas exagéré. En ces années où les réseaux sociaux n’existaient pas et où seule la télévision conférait une visibilité, la petite plaque en laiton apposée à la porte du 5 n’aimantait que faiblement l’attention du public. Le curieux qui entrait « pour voir » ne devait en aucun cas être déçu par son premier contact. S’il était accueilli par Evelyn, on pouvait être sûr de le voir revenir quelques temps plus tard avec des amis, aussitôt enrôlés dans la préparation d’un évènement. L’un des plus réussi, en dehors bien sûr des colloques universitaires, fut sans doute « la journée des jeunes » organisée, au siège même de l’Institut, en octobre 1978, rencontre à laquelle d’anciens ministres et collaborateurs parmi les plus éminents du Général acceptèrent de participer, en particulier Michel Debré et Maurice Schumann.
Au terme de ces rendez-vous aussi passionnants que studieux, il n’était pas rare qu’on se retrouve pour une soirée improvisée dans le bel appartement qu’elle occupait au premier étage d’une maison Napoléon III de la rue Desbordes-Valmore. Pour nous tous, avides d’anecdotes sur le de Gaulle familier qu’elle avait connu entre ciel et terre, ces moments étaient un enchantement. À l’époque, la presse rivalisait d’échos sur les caprices pseudo-monarchiques du deuxième successeur du Général et le contraste était saisissant entre ce qu’Evelyn nous rapportait de la simplicité de l’un et la manière dont l’autre se comportait avec son personnel de bord, exclu du prochain voyage à la moindre faute… ou réputée telle.
Malgré l’extrême affabilité du Général avec ceux qui peuplaient son quotidien, un jour, tout de même, elle s’inquiéta pour son matricule. C’était le 16 octobre 1964, au retour de l’inoubliable tournée en Amérique du sud. Sur le menu du déjeuner, était inscrit « melon au porto ». Mais on s’aperçut, après avoir décollé de Rio de Janeiro que si les melons étaient bien là… le porto avait été oublié à Paris ! Devant le désarroi du cuisinier, Evelyn, experte en cocktails, trouva la solution : elle remplit les melons avec un mélange de sa composition dont j’ai oublié le détail, mais dont le résultat ressemblait fort à l’objet du délit. Le subterfuge passa inaperçu… Sauf pour le Général qui lui demanda si son porto n’était pas plutôt brésilien que portugais !
Pour autant, la nostalgie n’était pas son fonds de commerce tant primait, chez elle, l’envie d’agir. Estimant d’entrée de jeu qu’elle n’assumerait pas pleinement son rôle de responsable des relations extérieures en se contentant de recevoir dans son bureau du premier étage qui, pourtant, ne désemplissait pas, elle décida d’aller au-devant des autres. C’est elle qui proposa à Pierre Lefranc d’organiser des expositions de Gaulle dans les départements. Tout était à inventer. Elle s’y attela. Bientôt, ce dispositif itinérant fut complété par des conférences et des dédicaces qui ne furent pas pour rien dans le rayonnement de la maison. Ce premier tour de France s’acheva en apothéose à Paris par la grande exposition organisée à l’Hôtel de ville sous le patronage de Jacques Chirac et en présence de Valéry Giscard d’Estaing, en octobre 1978, pour le vingtième anniversaire de la V° République. Giscard ne fit qu’une apparition mais Chirac, en maître de maison, s’attarda à la réception inaugurale, salle Saint Jean. Gaston Palewski, qui n’était jamais à court d’amabilités envers les jolies femmes, lui présenta Evelyn comme celle sans qui l’exposition n’aurait pu avoir lieu. Ce qui n’était pas entièrement faux… Mais loin d’être totalement vrai, la mairie de Paris et l’Ordre de la Libération, entre autres, ayant grandement participé à son élaboration. Sans se départir de son sourire, mais d’un ton sans appel, elle rectifia aussitôt le tir et souligna que, sans le concours de l’Hôtel de ville, l’exposition n’existerait pas. Manifestement sous le charme, le maire de Paris fit comme s’il n’avait pas entendu son démenti : « Grâce à vous, en tout cas, j’ai pu croiser M. Giscard d’Estaing. Voilà deux ans que cela n’était pas arrivé ». Depuis que Chirac avait claqué la porte de Matignon, en août 1976, les deux hommes, c’est vrai, ne s’étaient pas revus.
Ainsi était Evelyn Oudinot : d’elle émanait une telle énergie qu’on lui prêtait même l’improbable. Il faut dire qu’elle avait été formée à rude école : décorée de la Croix de guerre pour avoir servi comme ambulancière sur le front d’Alsace et en Allemagne, tout au long de l’hiver 1944-45, elle fut aussi et surtout une pionnière de l’aviation intercontinentale. Elle vola sur des DC 4 qui mettaient 24 heures pour traverser l’Atlantique (avec escale) puis sur les premiers Constellation qui, d’une traite, mettaient moitié moins de temps… Mais pour arriver quasiment à court d’essence si un embouteillage à Idlewild (devenu Kennedy Airport) les forçait à faire quelques « tours de manège » avant de se poser. Deux expériences d’où lui étaient resté un immense sang-froid… et un humour à toute épreuve. Elle racontait qu’elle avait trouvé un moyen imparable de détendre l’atmosphère quand un passager s’inquiétait de savoir si l’on aurait assez de carburant pour tenir en l’air suffisamment longtemps : « Ne vous inquiétez pas, disait-elle, nous avons des réserves de secours dans les bouteilles de Scotch » !
Des deux qualités, on imagine que c’est la première qui conduisit Air France à la désigner, en 1959, comme hôtesse personnelle du président de la République. Sans que celui-ci, apparemment, trouve à redire à la seconde, puisqu’Evelyn l’accompagna, jusqu’en 1969, dans tous ses déplacements, à bord de la Caravelle présidentielle. Leur dernier voyage fut pour se rendre à Washington, aux obsèques du président Eisenhower. Elle se souvenait qu’en débarquant à Orly, le Général la remercia comme chaque fois, mais en lui serrant la main un peu plus longuement que d’ordinaire. Elle en conserva l’impression d’une sorte d’adieu. Ce en quoi elle ne se trompait pas puisque, trois semaines plus tard, de Gaulle perdait le funeste référendum du 27 avril et rentrait le soir-même dans son village. Ils ne se revirent jamais.
Pour elle, commencerait une nouvelle carrière, plus loin des étoiles mais conforme à la fidélité absolue qu’elle vouait à l’Homme du 18 juin. Peu après avoir quitté l’Institut, en 1984, on lui découvrit une maladie cardiaque. Elle qu’on croyait indestructible s’éteignit brusquement, en 1990, sans avoir jamais quitté son sourire de légende.