YVONNE GEISMAR
Les secrets d’une combattante
par Éric Branca
Écrivain, journaliste
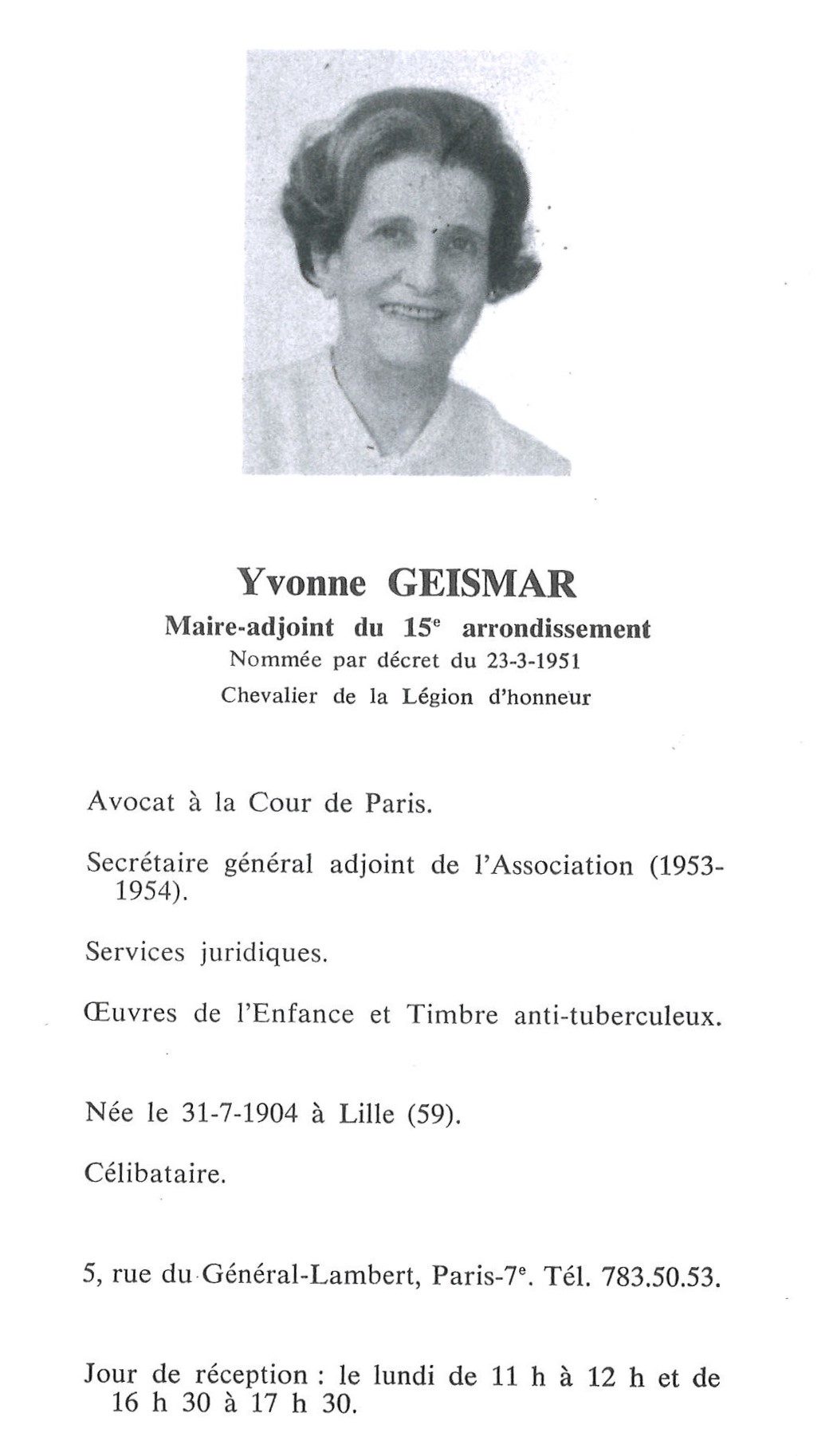 D’Yvonne Geismar, les étudiants et les chercheurs qui, au tournant des années Soixante-dix et Quatre-vingt, fréquentaient la bibliothèque de l’Institut Charles de Gaulle, gardent le souvenir d’une vieille dame aussi chaleureuse qu’impérieuse qui, entre deux bouffées de Gitanes, leur indiquait d’une voix gutturale dans quel rayon satisfaire leur curiosité, le cas échéant en désignant l’ouvrage du bout de son parapluie. Un accessoire qu’elle avait depuis longtemps dissocié de la météo et lui servait indifféremment de canne ou de baguette professorale quand, au détour d’une promenade dans Paris, qu’elle sillonnait à pied et en tous sens, elle vous entretenait de la physionomie d’un immeuble ou de l’histoire d’un quartier.
D’Yvonne Geismar, les étudiants et les chercheurs qui, au tournant des années Soixante-dix et Quatre-vingt, fréquentaient la bibliothèque de l’Institut Charles de Gaulle, gardent le souvenir d’une vieille dame aussi chaleureuse qu’impérieuse qui, entre deux bouffées de Gitanes, leur indiquait d’une voix gutturale dans quel rayon satisfaire leur curiosité, le cas échéant en désignant l’ouvrage du bout de son parapluie. Un accessoire qu’elle avait depuis longtemps dissocié de la météo et lui servait indifféremment de canne ou de baguette professorale quand, au détour d’une promenade dans Paris, qu’elle sillonnait à pied et en tous sens, elle vous entretenait de la physionomie d’un immeuble ou de l’histoire d’un quartier.
Dès qu’on avait fait sa connaissance, on s’apercevait en effet que la capitale était l’une de ses grandes passions. À tout le moins la plus manifeste, inséparable de son engagement, dès la Libération, au côté du Général. Élue pour la première fois conseillère de Paris aux élections municipales de 1947 qui offrirent 56% des voix au RPF (40% à l’échelle nationale), elle resta maire-adjoint du XVe arrondissement jusqu’aux élections de 1977, date à laquelle elle choisit de ne pas se représenter pour s’investir bénévolement à l’Institut Charles de Gaulle. Presque jusqu’à sa mort, en 1989, on l’y trouvait chaque mercredi. Après trente ans passés à batailler au service du gaullisme politique – non seulement comme élue mais, comme avocate, à la tête de l’Association des Juristes pour une Démocratie Moderne (ADJM), qu’elle animait aux côtés de ses confrères Guy Chassin de Kergommaux et André Weil-Curiel – elle entendait se consacrer désormais au gaullisme historique. Dans ce temple du militantisme – pour en pas dire de l’activisme ! – qu’avait été, dans sa jeunesse, le 5, de la rue de Solferino, elle déployait des trésors de patience à réceptionner les ouvrages, les classer, mais aussi à les chroniquer dans la revue Espoir, quand ils lui semblaient dignes d’être connus. Surtout, elle n’aimait rien tant qu’orienter ceux qui lui demandaient de l’aide, y compris en leur prêtant, non sans parfois quelque imprudence, des livres issus de sa propre bibliothèque, s’il lui semblait que celle de l’Institut comportait des lacunes !
C’est en travaillant sur mon mémoire de maîtrise, consacré au 18 juin 1940, qu’à l’automne de 1979, je rencontrai pour la première fois cette figure dont j’étais loin de soupçonner le rôle et l’importance passés. Pierre Lefranc, devant qui j’évoquais le nom de Colette Dernis, fille aînée de Paul Reynaud et rare témoin encore vivante (avec Gaston Palewski) des combats menés par de Gaulle avant- guerre, me conseilla un jour de passer par Yvonne Geismar pour la rencontrer. « Yvonne, me dit-il, est l’une de ses amies. Et quoiqu’il arrive, elle vous aidera dans vos recherches. C’est une mémoire vivante qu’on ne perd jamais de temps à écouter ». Ce que je pus vérifier dans les années qui suivirent, au fil de nos déjeuners au café Solferino où « Mademoiselle Geismar » – comme nous l’appelions tous, en n’oubliant jamais, sur sa recommandation, de prononcer ‘‘Guesmar’’, à l’Alsacienne – débarquait, chaque mercredi, à 12h 30 tapantes, parapluie en main. En ces temps où la loi Bachelot appartenait à la science-fiction, la table où elle s’installait se signalait aussitôt par des volutes de fumée qu’il était impossible d’ignorer. C’était le signal de son arrivée auquel Guy, son serveur attitré, répondait en lui apportant, dans un mouvement aussi rôdé que solennel, un verre de rouge et une omelette…
C’est en partageant ce moment rituel que je pus, de fait, rencontrer Colette Dernis, qui me parla non seulement du colonel de Gaulle, croisé plus d’une fois dans le salon de son père, entre 1935 et 1939, mais aussi du maréchal Pétain, au côté duquel elle eut, en 1937, l’occasion de dîner, et chez qui elle décela, comme avant elle l’auteur du Fil de l’épée, « un désintérêt sénile et une ambition sénile de tout »… C’est à cette même table que je pus rencontrer quelques-unes des amies de jeunesse d’Yvonne Geismar qui m’aidèrent à reconstituer, par petites touches, presque clandestinement, un passé qu’elle n’évoquait jamais sauf, disait-elle, « si cela peut apporter quelque chose aux jeunes »… Parmi ces femmes d’exception qui la tenaient en haute estime, et cela se voyait : Simone Cahen-Salvador, dont le mari, Jean, conseiller d’État révoqué par Vichy en raison de ses origines juives puis interné à Drancy, réussit à s’échapper du train qui le menait vers Auschwitz avant de devenir, après-guerre, l’un des pères de la Sécurité sociale au côté de Pierre Laroque ; et surtout l’étonnante Jeannine Alexandre-Debray, (mère du philosophe Régis Debray), élue en même temps qu’elle au conseil de Paris en 1947 sur la liste du RPF, avant de devenir sénatrice en même temps qu’une pionnière de l’égalité hommes-femmes. Un combat qu’elle partageait avec Yvonne Geismar qui, avocate comme elle, mais de neuf ans son aîné, avait commencé sa carrière, en 1930, au cabinet de Joseph Paul-Boncour.
Étonnant envol que le sien ! La jeune Yvonne n’a pas vingt-six ans et possède, à défaut de l’expérience des prétoires, un caractère bien trempé : moins d’un an plus tard, elle quitte Paul-Boncour pour s’associer avec son cousin germain Max Hymans, lequel deviendra, en 1938, secrétaire d’État de Léon Blum – mais aussi et surtout, après une belle Résistance, le premier président d’Air France, de 1948 à sa mort, en 1961. Pourquoi s’émancipe-t-elle si rapidement de la prestigieuse écurie de Paul-Boncour, rendu mondialement célèbre par sa défense de la famille Jaurès dans le procès qui, en 1919, acquitta scandaleusement Raoul Villain, l’assassin du leader socialiste ? Parce que ce même Paul-Boncour, député en même temps qu’avocat, tenait à déposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant, en cas de guerre, à « mobiliser les Français sans distinction de sexe ». Réaction de sa jeune collaboratrice : « D’accord pour qu’on dispose de ma vie, mais quand les hommes m’auront accordé le droit de vote ! »
De cette rébellion fondatrice naîtra l’admiration que Jeannine Alexandre-Debray portait à son amie Yvonne qui la laissait raconter l’anecdote sans ajouter autre chose qu’un laconique : « Normal, non ? ». Telle était Yvonne Geismar : éloquente jusqu’à étourdir, paraît-il, ceux qui l’écoutaient plaider (d’où, peut-être, le choix de Jacques Soustelle d’en faire l’une des avocates du RPF dans le cadre de ses contentieux électoraux) ; hypnotique quand elle évoquait Huysmans et Proust, ses deux idoles littéraires dont elle animait la société des amis respectifs… mais décidément « taiseuse » quand il s’agissait de raconter sa propre vie.
« Les grandes douleurs sont muettes » a dit Sénèque. D’où, sans doute, le silence de l’intéressée sur les drames qu’entre 1940 et 1945 avait subis sa famille, dont tant et tant de membres n’étaient pas revenus des camps. Elle-même disait seulement qu’elle avait eu de la chance, après s’être réfugiée en zone sud avec sa mère, de ne pas attirer l’attention de la Milice et de la Gestapo, et même, quelques années plus tard, quand on lui avait restitué les centaines d’ouvrages rares pillés par les Allemands dans l’appartement familial du XIVe arrondissement, puis retrouvés par hasard, en 1947, dans l’entrepôt d’un libraire de Munich… Quand elle les montrait à ses invités, soigneusement classés dans son salon bibliothèque de la rue du Général-Lambert, non loin du Champ-de-Mars, il lui arrivait cependant de murmurer : « Ce sont les livres de mon père… Mais comme j’aurais préféré qu’ils restent en Allemagne et qu’on me rende mes cousins vivants ! ».
Mort en 1931, le général Gédéon Geismar, issu d’une des plus anciennes familles juives d’Alsace, était un personnage hors-normes. Fidèle au judaïsme en un temps où beaucoup d’Ashkénazes se ralliaient à une stricte laïcité (comme le capitaine Dreyfus), embrassaient l’athéisme ou se convertissaient plus classiquement au christianisme, ce polytechnicien spécialiste de l’artillerie n’avait choisi l’armée qu’à une condition, renouvelée au fil de chacune de ses affectations : qu’existât une synagogue dans la garnison où il serait nommé. Il faut dire que sa connaissance parfaite de la langue et de la culture allemandes en faisait une perle rare : outre le fait d’avoir choisi la France après le traité de Francfort de 1871 (ce qui explique la naissance de sa fille Yvonne à Lille, en 1904), son seul point commun avec Dreyfus fut d’avoir traduit, à mesure qu’ils paraissaient, la plupart des traités d’artillerie allemands pour le compte de l’état-major français. Mais cet érudit était aussi un homme d’action : décoré de la légion d’honneur (commandeur) à titre militaire, titulaire de la croix de guerre avec une citation à l’ordre de l’armée rendant hommage à son « talent d’organisation », sa « maîtrise » et « une activité au-dessus de tout éloge », c’est en officier couvert de gloire qu’il prend sa retraite en 1923. Libéré de son devoir de réserve, il passera les dernières années de sa vie en combattant pour la cause sioniste au sein, notamment, de deux organisations : le Fonds social juif (Keren Hayesod), lancé en 1920 afin de doter le mouvement sioniste des ressources nécessaires au retour de volontaires sur la Terre d’Israël et le Fonds national juif (Keren Kayemeth Leisrael ou KKL) créé en 1901 par le fondateur du sionisme, Théodore Herzl, pour aider les juifs de Palestine à créer un embryon d’État.
Par conviction autant que par fidélité, il n’est guère étonnant qu’à partir de 1945, Yvonne Geismar ait rejoint la cause sioniste, parfaitement jointive, rappelons-le, avec l’engagement du général de Gaulle en faveur de la création de l’État d’Israël, mais aussi d’un État palestinien – double principe voté par l’ONU en 1947 et dûment accepté par David Ben Gourion mais que les Arabes, poussés par la Grande-Bretagne, avaient préféré rejeter pour déclarer dans un bel ensemble la guerre à Israël… Et la perdre. C’est ainsi que, parallèlement à son militantisme RPF, elle s’engage dans l’Alliance israélite universelle et l’organisation internationale des femmes sioniste (la Wizo), mais aussi dans une action plus discrète, que seuls ses papiers personnels, remis à la Fondation Charles de Gaulle par sa famille, a permis de découvrir, en faveur des orphelins de la Shoah. Comme avocate, mais aussi comme élue de Paris, ce bénévolat mobilisa son énergie. Sans jamais obérer l’humour qui, chez elle, affleurait à la moindre occasion. Ainsi de cette lettre adressée au directeur d’un orphelinat talmudique qui, organisant, en 1954, un gala de charité en faveur de ses élèves, privés de parents et de ressources, craignait de voir son établissement taxé sur les fonds récoltés : « J’ai expliqué [à l’inspecteur central des contributions indirectes] que vous organisiez un dîner et qu’au cours de ce dîner, vous pensez offrir un récital de violon à vos hôtes (payants) tout comme aurait fait un prince évêque de Salzbourg au XVIIIe siècle ».
Tout Yvonne Geismar se retrouve dans ces quelques lignes où se mêlent générosité, humour et culture. Celle d’une vieille Europe qu’elle avait vue disparaître dans la tragédie du siècle, mais qui, envers et contre tout, continuait à vivre en elle. Dans ce qui seraient ses derniers vœux au général de Gaulle, en date du 30 décembre 1969, elle avait écrit ces mots sous lesquels transparaît, proportionnel à l’admiration qu’elle lui porte, le reproche voilé d’avoir organisé ce qu’elle tenait, à l’instar de Malraux, pour un référendum-suicide : « Il faut lui pardonner, à notre France, de s’être privée de vous ; elle ne sait pas toujours ce qu’elle fait quand on l’envoie aux urnes. Et vous savez bien que lorsqu’elle le comprendra, il sera trop tard ».
Le moins qu’on puisse dire est que la suite ne l’aura pas démentie…




