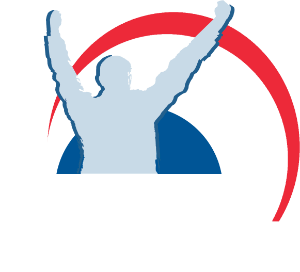GLIÈRES
par Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Conférence prononcée à Annecy, le 10 avril 1994.
Fonds Maurice Schumann, Fondation Charles de Gaulle.
Le 2 février 1944, tous ceux qui, en France, prenaient l’écoute de la radio de Londres entendirent un dramatique appel. Le porte-parole du Comité français de la Libération nationale sonnait l’alarme [1] :
« Alerte aux maquis ! Alerte à la Haute Savoie ! Allo, allo, S.O.S. L’Oberführer Joseph Darnand a décidé de déclencher demain 3 février une attaque massive contre les patriotes retranchés dans les montagnes de Haute-Savoie (…).
Soldats sans uniforme des maquis de Haute-Savoie, il faut que vous appliquiez, sans perdre une minute, votre dispositif de défense ».
Le porte-parole précisait les effectifs engagés contre les maquis ; il énumérait les noms des officiers de police responsables de l’opération :
Chaque goutte de sang qui demain, peut-être par votre faute, coulera dans les ravins et les gorges de notre Haute-Savoie retombera sur vos têtes.
Le surlendemain, l’appel dramatique était renouvelé : Allo, allo, S.O.S, S.O.S, Savoyards, Savoyards, le maquis de Haute-Savoie, le front français…
Mais cette fois, le porte-parole, reprenant les consignes reçues de chefs responsables de Haute-Savoie, ordonnait à tous les sédentaires armés de rejoindre les maquis, aux ouvriers de faire grève, à tous les patriotes de multiplier les sabotages.
La grande voix de Maurice Schumann donnait à ces appels une intensité bouleversante. Ils sont inoubliables pour qui les a entendus. Pour la première fois, un épisode de la résistance militaire intérieure était rendu public dès le premier instant, comme ç’avait été le cas deux ans plus tôt pour Bir Hakeim. Cet épisode, les auditeurs allaient le vivre non pas « en direct », comme on dit aujourd’hui, mais avec le seul délai imposé par la transmission des messages clandestins. Et avec le suspense terrible d’une issue incertaine.
« L’affaire des Glières » commençait : elle devait se prolonger près de deux mois. Elle allait inscrire en lettres de sang dans notre histoire l’héroïsme des 460 maquisards qui, les premiers depuis 1940, affrontèrent ouvertement les forces allemandes et hissèrent les couleurs sur une fraction libérée de notre sol.
Ce combat, puis ce drame, j’ai eu le privilège d’en être à distance un des témoins, à Londres, sous l’uniforme de la France Libre : j’ai eu jour par jour en main les télégrammes parfois des tronçons de télégrammes – qui le relataient. Nous en avons suivi les péripéties avec fierté, puis avec angoisse. C’est pourquoi j’ai eu à cœur de contribuer à l’hommage dû aux héros, mais aussi de déchiffrer ce qui a pu passer pour l’énigme des Glières : le choix, contraire aux règles de la guérilla, de combattre jusqu’au bout sur place. Le souvenir des martyrs se doit d’être véridique : je m’efforcerai de retracer ce qu’il en fut en m’appuyant moins sur les témoignages que sur les documents d’époque aujourd’hui accessibles.
L’épopée des Glières est extraordinaire non seulement comme symbole de l’héroïsme, mais aussi parce que se situant à un tournant de la guerre clandestine, elle a été le premier révélateur des problèmes de la Résistance militaire à l’approche du débarquement : problèmes de la difficile liaison avec les états-majors alliés ; problème de l’insurrection nationale (quand la faire et sous quelle forme ?) ; problèmes de tactique (comment concevoir l’action armée clandestines ?) ; problèmes politiques : la nation prouverait-elle vraiment sa volonté de participer à sa libération ? Ainsi l’affaire de Glières a sa place à la fois dans l’histoire de l’élaboration de la stratégie alliée et dans l’histoire locale ; elle a, dès l’origine, un volet politique à côté du volet militaire. Et Glières comporte deux registres, comme certains tableaux du Moyen Age où se superposent deux mondes, celui d’en haut, celui des pauvres mortels se débattant au ras de terre et celui des puissances extérieures, agents de la fatalité et porteuses des voix célestes.
La bataille clandestine, les Savoie la connaissent en janvier 1944 depuis un an. Occupées en novembre 1942 par les Italiens, puis en septembre 1943 par les Allemands, elles sont devenues, au dire des autorités de Vichy, un des « foyers d’insécurité » les plus actifs de France. Ce sont des zones de refuge : le Service Obligatoire du Travail pour 1’Allemagne, imposé par la loi du 16 février 1943, y a fait affluer les jeunes réfractaires : ils y seraient plus de 5 000, s’ajoutant aux réfractaires locaux. La population est la plus secourable, avec celle du Dauphiné et des Cévennes. Cet afflux s’est conjugué avec la naissance de ce que l’on a baptisé, un peu pompeusement l’Armée secrète. Celle-ci est devenue une réalité en Haute Savoie grâce au commandant Vallette d’Osia,l’ancien commandant du 27e bataillon de chasseurs alpins. Passé à la clandestinité dès novembre 1942, il est entré en contact aussi bien avec le général Delestraint, délégué militaire national de la France Libre, qu’avec les chefs de l’Organisation de résistance de l’armée ; fort de son prestige sur ses anciens officiers, il a entrepris d’encadrer et d’organiser les premiers maquis et les sédentaires mobilisables…Il a obtenu des subsides américains en Suisse. Ses rapports sont parvenus à Londres et Alger. Les actions de résistance ont commencé à défrayer la chronique dans l’été 1943, tel cet engagement avec des forces italiennes aux Dents de Lanfon, dont la presse suisse a parlé. Elles se sont multipliées à l’automne : 177 attentats en octobre et novembre dans le département d’après le préfet qui a parlé de climat de « pré-guerre civile ». Des dénonciateurs et des collaborateurs ont été exécutés. Un jeune chef appelé Simon, s’est illustré par ses coups de main avant de succomber en janvier 1944.
Vallette d’Osia, arrêté en octobre 1943, a réussi à s’échapper et gagnera Londres. Le commandement militaire de la Haute-Savoie a alors été pris en charge par le chef de l’AS de l’Ain, Romans-Petit, publiciste et capitaine d’aviation de réserve, animateur et organisateur exceptionnel ; Romans-Petit s’était distingué par une opération hardie, la saisie du matériel du centre de l’intendance, en pleine ville de Bourg-en-Bresse ; il avait fait défiler ses maquisards dans Oyonnax le 11 novembre 1943, exploit au retentissement mondial.
Romans-Petit, venu donc en Haute-Savoie, y a créé en décembre 1943 à Manigod une école de formation de cadres qui enseigne les règles de la guérilla. Comme Vallette d’Osia, il s’appuie sur les cadres du 27e BCA, tels Anjot, Bastian, Jourdan et le jeune lieutenant Théodose Morel, dit Tom, précédemment instructeur à l’Ecole de Saint-Cyr repliée à Aix-en-Provence et dont il fait, malgré son jeune âge, son adjoint.
L’action résistante n’a pas fléchi pendant l’hiver. Un rapport allemand de janvier 1944 en témoigne [2] :
« Les terroristes sont de jour en jour plus provocants. Sur les routes de Haute-Savoie, ils attaquent en plein jour les voitures allemandes qui ne peuvent circuler qu’en convois protégés. A un passage à niveau intentionnellement fermé, ils ont assailli une voiture occupée par des officiers de la police militaire qui ont tous été blessés ».
Les archives allemandes signalent entre le 15 et le 21 janvier un attentat contre des douaniers allemands et douze attaques dans la région d’Annecy, puis, dans les six derniers jours du mois l’enlèvement de 32 véhicules et 3 tonnes d’explosifs et l’attaque d’un convoi allemand près du Petit-Bornand. L’intendant de police d’Annecy déplorera publiquement que des cantons entiers échappent à l’autorité gouvernementale.
Rien d’étonnant si c’est d’abord sur la Haute Savoie que s’abat la répression. Depuis décembre 1943, sur ordre des Allemands, des extrémistes de la collaboration participent au gouvernement de Vichy : Darnand chargé du maintien de l’ordre, Philippe Henriot responsable de la propagande. Laval veut justifier la confiance des Allemands en assurant la sécurité sur leurs arrières. Le 20 janvier, ont été créées des cours martiales devant lesquelles tout détenteur d’armes arrêté doit être traduit, le jugement sans appel étant exécutoire dans les 24 heures. Le 31 janvier, le département a été mis en état de siège, des convois de renforts roulent vers Annecy : selon les renseignements transmis à Londres, 12 escadrons de gardes mobiles et 5 groupes mobiles de réserve doivent être engagés.
Face à cette mobilisation, la compagnie de maquisards Jourdan-Joubert a reçu dans l’après-midi du 30 janvier l’ordre de monter au plateau des Glières où déjà cantonne une vingtaine de réfractaires : 120 maquisards de Manigod, Serraval et du Bouchet sont ainsi montés le 31 au plateau.
Pourquoi cette décision, et pourquoi Glières ?
Tom Morel, nommé par Romans-Petit chef des maquis de Haute-Savoie, s’en est expliqué en ordonnant le rassemblement : « devant les opérations de grande envergure lancées contre nous, il s’agissait de savoir si nous voulions être ou ne pas être. Laisser les camps existants isolés sans armes, sans ressources, revenait à les livrer les uns après les autres. Alors fallait-il faire la guérilla pour se défendre ? C’était impossible : nous manquions d’armes suffisantes pour équiper chacun de nos camps ; la neige empêchait toute mobilité [3] ».
Seule possibilité : grouper tout le monde, avec les armes existantes, dans une zone facile à défendre qu’on interdirait coûte que coûte le temps de recevoir les parachutages d’armes qui permettraient de reprendre la guérilla.
Car le manque d’armes est une obsession. La Haute-Savoie n’a reçu aucun parachutage depuis des mois, mais en janvier-février 1944, Romans-Petit espère. Je le cite [4]:
« J’ai obtenu de Londres par l’intermédiaire de Xavier, de son vrai nom Heslop, officier britannique de liaison auprès de moi, la promesse formelle de parachutages d’armes à la condition de proposer de nouveaux terrains, tous les autres ayant été grillés ou jugés inaptes. J’ai alors chargé mon adjoint, Tom Morel, de ce travail et c’est à la suite d’une prospection méthodique qui a duré plus d’un mois que mon choix s’est porté sur Glières. Ce plateau pouvait, en effet, permettre de nombreuses et importantes opérations en raison de son étendue et de sa position géographique. Glières a été accepté pour un ravitaillement en armes et en munitions.
J’ai désigné aussitôt Tom Morel pour commander un détachement d’une centaine d’hommes avec pour unique mission de résider sur place afin de recevoir et d’acheminer à n’importe quel moment, sans délai, les containers vers les unités.
Jamais, à aucun moment, il n’a été question de constituer un îlot. »
Glières a été homologué à Londres sous le nom de code d’Hippopotame avec cinq autres terrains proposés pour la région R1 ; le plateau est répertorié comme un des deux sites alpestres capables de recevoir plus de 80 containers, mais les autorités de Londres n’ont pris aucun engagement ni fait aucune promesse : Romans-Petit et Morel n’ont que des espoirs.
Il se trouve pourtant que leurs appels coïncident avec un changement de l’attitude alliée à l’égard de la Résistance.
Il faut rappeler ici ce qui s’es passé depuis un an dans les coulisses du monde libre. Dès le début de 1943, la France Combattante a considéré les Savoie et l’Ain comme une zone de résistance privilégiée : la conjonction des réfractaires et des officiers de chasseurs alpins démobilisés pouvait y donner substance à une armée secrète jusque-là fantomatique. Le 16 mars 1943, Jean Moulin, alors à Londres, a télégraphié à son secrétariat clandestin d’ouvrir des crédits à tous les mouvements et groupes pour « porter assistance aux patriotes de Savoie, notamment en fournissant des caches » ; il a obtenu des Anglais 6 000 cartes d’identité, d’alimentation et de recensement, ainsi qu’un premier parachutage d’armes et de vivres, réclamé déjà par les résistants locaux, parachutage qui a eu lieu, précisément aux Glières [5]. De gaulle a demandé en même temps à Churchill des moyens de subsistance et des armes pour les 50 000 hommes de l’Armée secrète, « d’une grande valeur combattive », que menace le STO [6]. Le Premier ministre lui a répondu que c’était hors de question : « une aide d’une telle ampleur, expliquait-il, allant à l’encontre de notre politique qui est d’empêcher la vague de rébellion actuelle de s’étendre ». Le 19 mars, les chefs d’état-major britanniques ont confirmé que l’action en France devait se limiter pour l’année en cours à des actions de sabotage à l’exclusion de la guérilla [7]. En août 1943 puis de nouveau en novembre, Churchill a arbitré en faveur de l’armement prioritaire des seules guérillas de Grèce et de Yougoslavie et des maquis italiens. Le fait est que l’état-major britannique a mis longtemps à croire à la réalité et à l’efficacité de l’Armée secrète ; il y a cru moins encore après l’arrestation de l’état-major de la Résistance à Caluire. Sachant que le débarquement n’aurait lieu qu’en 1944, il n’a cessé de redouter des insurrections inconsidérées ou du moins prématurées dans un pays qu’il estimait géographiquement peu favorable à la guérilla. La mission que ls Anglais assignent à la Résistance militaire française est étroitement circonscrite : ils attendent d’elle qu’elle retarde, dans la première phase du débarquement allié, la concentration des renforts allemands vers la tête de pont, et cela, avant tout, par le sabotage généralisé des voies ferrées et des transmissions.
Cette conception étroitement technicienne, de Gaulle la rejette : la Résistance est pour lui un mouvement national, elle doit dès maintenant attester que la France n’est pas sortie de la guerre ; elle devra, au moment opportun, apporter aux alliés la contribution éclatante d’une insurrection nationale.
Or, dans la deuxième quinzaine de janvier 1944, on constate un retournement de l’attitude britannique : le débarquement de Normandie est maintenant décidé ; il comporte des risques tels que les Alliés tiennent à mettre tous les atouts dans leur jeu : pour retenir le maximum de forces ennemies loin de la Normandie, les états-majors misent non plus seulement sur les sabotages, mais aussi sur la guérilla, ce qui implique d’armer enfin les maquis. La Haute-Savoie va en bénéficier. Le 14 janvier 1944, Churchill a promis des armes à Emmanuel d’Astier ; le 22 janvier, Eisenhower a été également encourageant. Le 27, au cours d’une réunion franco-britannique convoquée à Downing Street, Churchill ordonne qu’on fasse le nécessaire pour armer au cours du mois de février 8 000 hommes dans les trois régions R1, R2 et R6, c’est-à-dire l’ensemble alpin et le Massif central, la priorité devant aller aux grandes Alpes. Il imagine les Alpes s’embrasant du Rhône à la Méditerranée, le maquis français faisant pendant aux maquis yougoslaves, avec les Savoie pour pôle. Sa vision insurrectionnelle va à l’encontre de tout ce que professe son état-major ; les mesures d’exécution suivent néanmoins : des réunions franco-britanniques à très haut niveau ont lieu les 28 et 29 janvier, les 7 et 9 février. La RAF se fera prêter des avions par les Américains, on affectera les équipages les plus expérimentés au ravitaillement des maquis français, on enverra non seulement des mitraillettes, mais des fusils-mitrailleurs, et on doublera les envois en mars. A la réunion du 7 février, le commissaire à l’Intérieur Emmanuel d’Astier demande des mesures exceptionnelles pour la Haute-Savoie menacée et où « un échec aurait une répercussion d’une extrême gravité sur l’ensemble de la Résistance [8] ».
La compréhension des événements exige un second retour en arrière. L’arrestation de Jean Moulin et du général Delestraint en juin 1943 a révélé la fragilité d’une organisation centralisée et pyramidale de la Résistance. Les Anglais ont exigé que l’organisation militaire clandestine soit décentralisée. Aussi le BCRA a entrepris un formidable effort pour recruter et envoyer en France des délégués militaires régionaux. Ces nouveaux venus sont chargés de conseiller et de contrôler les organisations locales ; ils ont parfois peine à s’imposer. Mais choisis par Londres, reliés par radio avec Londres, ils ont qualité pour demander des parachutages.
C’est ainsi que se trouve au début de 1944 en Haute-Savoie un délégué militaire qui va jouer dans l’affaire des Glières un rôle majeur, le capitaine Jean Rosenthal alias Cantinier, nom de code : Apothème. Jean Rosenthal a 37 ans ; il est le fils d’un des joailliers les plus en vue de Paris dans l’entre-deux-guerres ; il a franchi les Pyrénées fin 1942 et gagné Londres où il s’est engagé dans les FFL. Il s’y est lié avec Maurice Schumann, porte-parole de la France Libre et avec le comandant Manuel, le n° 2 du BCRA. Affecté aux forces françaises en Tripolitaine, il y a été grièvement blessé. Il a été ramené e Angleterre où, sitôt rétabli, il s’est porté volontaire pour une mission en Haute-Savoie, région qu’il connaissait bien. La mission Musc, première mission franco-britannique d’information, l’a associé à un officier anglais, le lieutenant-colonel Heslop, dit Xavier ; cette mission devait, en l’espace d’une lunaison, être septembre et octobre 1943, évaluer les ressources en combattants potentiels des dix départements de la région de Lyon. Cantinier, de retour à Londres, a fait état de 2 350 hommes encadrés et prêts à combattre. La hâte des services était telle que Heslop et lui ont été renvoyés en France à la même lune en qualité d’officiers de liaison auprès de l’Armée secrète des trois départements de l’Ain, du Jura et de la Haute-Savoie, en fait auprès de Romans-petit. L’activité de Rosenthal-Cantinier pendant les trois premiers mois est attestée par ses télégrammes qui sont autant d’appels de détresse [9] :
- 18 septembre : Action immédiate dangereuse et impossible du fait défaut parachutages. Situation intolérable. Manque armement nous mène tous au suicide…
- 30 décembre : Invivable. Câblez franchement vos projets. Ai besoin vos contacts, vos informations. Si vous ne pouvez rien, préfère savoir la vérité.
- 7 janvier : Préférez-vous terrains très enneigés, hauts et défendables, ou bien vallées larges, meilleure réception, mais défense difficile ?
Ce n’est pas sur Glières qu’il recommande jusqu’au début de février de faire des parachutages, mais au col des Saisies, qui lui paraît « idéal » pour larguer du matériel ou des hommes, sous réserve d’un préavis suffisant. C’est seulement le 7 février qu’il demande un parachutage massif aux Glières : 300 hommes y sont maintenant, explique-t-il ; il réclame pour eux le double des munitions prévues, des conserves, des lainages, des chaussettes de ski [10]. A partir du 17 février, il recommandera de concentrer, au moins provisoirement, les parachutages de Haute-Savoie sur Glières.
Cantinier devient, en ce début du mois de février, un acteur de premier plan, car Romans-Petit doit se replier sur l’Ain où les Allemands lancent une offensive contre les maquis ; il va être ainsi pendant trois mois l’interlocuteur attitré de Londres en Haute-Savoie. Sans exercer de commandement, il a un rôle clef. Le délégué militaire national, Louis Mangin et le délégué militaire pour la zone sud Bourgès-Maunoury l’ont assuré de leur confiance [11]. Entreprenant, ardent, il communie dans le même patriotisme et le même sens de l’honneur que Morel et que les chefs de l’AS de Haute-Savoie, Clair-Navant et Anjot. Il est en outre instruit des luttes que mène de Gaulle dans le camp allié, aussi a-t-il une vue non pas seulement militaire, mais politique de la Résistance : il souhaite qu’elle témoigne avec éclat pour la France. Ayant découvert Glières, on peut dire qu’il a voulu Glières.
Devant l’offensive de Vichy, il a été le premier à alerter Londres. Il n’est pas le seul. Dans la première décade de février, toutes les autorités civiles et militaires clandestines réclament non seulement une aide matérielle, mais la mobilisation de toutes les ressources de la Résistance au profit de la Haute-Savoie, fût-ce contre l’avis des Alliés. Bourgès-Maunoury intervient dans ce sens, mais aussi le futur général Descours, commandant de la région R1, auteur d’un télégramme angoissé qu’Emmanuel d’Astier lit le 7 février devant les états-majors londoniens, et ce télégramme remontera jusqu’à Eisenhower [12] :
« Très urgent. Donnons ordre prêter main forte à Savoie. Vous demandons instamment envoi urgence troupes parachutées et armes, surtout fusils-mitrailleurs, ainsi qu’attaques par aviation […] Sommes prêts à soutenir lutte, mais avons besoin aide extrême urgence ».
Le lendemain 8 février, c’est le délégué général par intérim du Comité national Bingen qui vient à la rescousse : le bureau confédéral de la CGT clandestine demande l’intervention de parachutistes et d’aviation, ainsi que la distribution des armes stockées et la diffusion par la BBC de consignes appelant au harcèlement des forces de répression et à la grève générale dans la région ; le bureau du Conseil national de la Résistance fait chorus [13]. C’est dire que l’appel mobilisateur de Schumann, le 4 février, répondait à une demande concertée venue de France.
Mais à Londres, on craint de lâcher la bride avant le jour J à des insurrections qui seraient vouées à l’échec. On décide de freiner. Ce revirement provoquera un mois de débat occulte entre les responsables français de Londres et ceux de la clandestinité. Il donne lieu à la première des escarmouches opposant, à l’approche du jour J, les autorités de Londres aux activistes de la Résistance qui, aiguillonnés par le parti communiste, prônent l’action immédiate et une insurrection nationale rapide. Le 7 février au soir, donc, Schumann donne un coup d’arrêt : il renverse les consignes antérieures : il prescrit aux maquis la tactique du harcèlement et du décrochage, car dit-il, la France d’aujourd’hui aura toujours trop de martyrs ; la France de demain n’aura jamais trop de soldats.
Et le 8 février, les Anglais font diffuser par la BBC qu’ « il ne faut jamais résister jusqu’au bout s l’ennemi est supérieur ».
Décrocher, la question ne se pose pas à ce stade pour les maquisards des Glières. La neige rend le plateau inaccessible. Ils y sont en sécurité. Au contraire, les camps de vallée sont vulnérables, les barrages de police su multiplient sur les routes, des patrouilles fouillent les villages. Pour échapper à la menace, de nouveaux groupes rejoignent le plateau. « On a eu peur quand il y a eu l’état de siège et on est montés ». Cinquante-six républicains espagnols, affectés après l’armistice à des camps de travail en haute montagne, pour la plupart bûcherons, risquent d’être déportés en Allemagne : ils se sont repliés sur le Bouchet ; ils reçoivent l’ordre de gagner le plateau. Des groupes de La Clusaz, du Grand Bornand et d’Entremont rejoignent. Le premier parachutage est vite connu dans la région ; cent rumeurs circulent. On craint d’être arrêtés, on veut des armes, et le prestige du maquis grandit. Dans la seconde quinzaine de février, un groupe de Thorens monte spontanément, puis deux groupes de FTP menacés ; ils constitueront les sections La Chamois et Liberté Chérie. Il semble pratique de les laisser venir s’armer sur place plutôt que d’avoir à évacuer les armes.
Plusieurs facteurs concourent à faire durer le groupement. Le premier parachutage ne vient qu’en fin de lune, le 14 février, et il est modeste : 3 avions, une cinquantaine de containers et de paquets. Encore plus modeste, le parachutage de la nuit du 4 mars : 2 avions, 29 tubes et colis. On espère davantage. Tom Morel a le souci d’assurer la sécurité aussi longtemps que dureront les parachutages ; il est ainsi, lui-même, entraîné à faire durer l’implantation, ce qui le conduit, au début de mars, à demander 500 hommes de renfort au chef de l’Armée secrète de Haute-Savoie, le commandant Clair, qui les lui refuse.
Le fait de durer renforce la confiance. Pourtant la vie est rude dans la citadelle du plateau, même si une quarantaine de chalets qu’on aménage sommairement procurent des abris. Les vêtements chauds, les chaussures font défaut ; le blocus policier rend le ravitaillement difficile. L’aspirant Bastian, resté dans la vallée, draine les vivres auprès des paysans ; des colonnes de traineaux les acheminent, mais bientôt, il faut les monter à dos d’hommes. Cantinier demande à Londres, outre des munitions, « pain de guerre, fruits secs, café, sucre, thé, riz, chocolat, tabac, conserves, de même que gants, chaussettes, passe-montagne, sous-vêtements de laine, bérets ». Le plus important parachutage apportera 2 à 3 jours de nourriture. Fin mars, le blocus sera près d’affamer les défenseurs.
Le moral est néanmoins élevé. Le lieutenant Morel donne sa mesure de chef. Saint-cyrien de 1937, fait chevalier de la Légion d’honneur pour avoir capturé, en juin 1940, une compagnie italienne sur le front des Alpes, cet homme ardent est l’âme de Glières. Il n’y aura jamais plus de cinq officiers assistés de quelques sous-officiers d’active pour encadrer ce qui devient u bataillon. Leurs noms ? Bastian, de Griffolet, Jourdan, Lalande, auquel se joindra le noble capitaine Anjot.
Douze sections sont constituées, chacune avec son secteur à surveiller et à défendre, ses avant-postes, ses emplacements d’armes automatiques, ses igloos édifiés pour y monter la garde. Le PC est relié aux sections par des coureurs qui, les jours de tempête, avancent péniblement dans la neige. Morel constitue un corps franc de 25 jeunes éclaireurs-skieurs bien armés. Si les réfractaires savoyards sont le plus nombreux, toutes les régions sont représentées. Sur 51 des jeunes Français arrêtés après la chute du plateau et dont les interrogatoires sont conservés aux Archives nationales, 12 viennent des provinces périphériques (Lyonnais, Bourguignons, Comtois, Dauphinois), mais 10 sont Parisiens, 4 Lorrains, 2 Normands, 2 Tourangeaux, 3 Méridionaux ; on compte même un gars du Nord et un Rochelais.
« Il s’est passé en haut un phénomène psychologique étonnant », m’ont dit des survivants de Glières. « Nous étions des proscrits, des hors-la-loi. Brusquement, nous nous sommes sentis des hommes libres. Quand on mettait le pied sur le plateau, l’enthousiasme vous prenait. IL y a eu sur le plateau naissance de quelque chose d’autre, de nouveau : une convergence de courants, un climat unificateur, la création d’une communauté, la connaissance de l’autre, une nouvelle relation officier-troupe ». Une originalité de « l’esprit Glières » est la conjonction sans vrais problèmes, sous un même commandement et pour une même opération, des maquis de l’AS et des sections communistes des FTP. Le fait est trop rare pour n’être pas souligné : je rappelle que, depuis les négociations du printemps 1943 entre Jean Moulin, Brossolette et les porte-parole communistes, la doctrine invariable du commandement national FTP a été de dire Oui à l’intégration des états-majors de la Résistance, mais en maintenant l’autonomie totale de ses forces combattantes sur le terrain. Ce n’est pas le cas ici. L’esprit Glières, c’est l’œuvre de Morel. Il veut faire de ses hommes une avant-garde de l’armée de la libération. Ce saint-cyrien qu’on dit proche de l’Action française refuse de faire aucune distinction entre sections communistes et non communistes, bien que ls premières soient accusées par la propagande officielle d’avoir exécuté de sang froid un groupe de policiers civils. Le drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine flotte sur tous les chalets : chaque matin, il y a, pour chaque section, le salut aux couleurs ; il y a les exercices en armes, les veillées, les chants. Le dimanche 20 février, il y a un rassemblement général des maquisards du plateau qui adoptent la devise : « Vivre libres ou mourir ». Et ils savent, grâce à leurs postes de radio, que le monde extérieur connaît leur existence.
Pendant un mois et demi, les maquisards assiégés ont la maîtrise des opérations. Ils ont ordre de ne pas ouvrir le feu en premier sur des Français. Ils se heurtent à la Garde mobile dès le 7 février et à la Milice dès le 9. Le 12 février, un violent accrochage à l’Essert fait quatre tués dans les rangs de la Garde ; trois gardes sont faits prisonniers. Tom, en signe de bonne volonté, les libère après trois jours, sur intercession du curé du Petit-Bornand. Le 19 février, Londres reçoit de Cantinier le compte rendu suivant [14] :
« Admirable moral de nos maquis qui prennent chaque jour davantage figure de troupes régulières, disciplinés, parfaitement encadrés. Si ravitaillement se poursuit, nous aurons là une réserve d’hommes pour le jour J ».
Les maquisards s’enhardissent. Dans la nuit du 2 mars, ils font un coup de main sur Saint-Jean-de-Sixt pour libérer l’un des leurs, le jeune médecin du maquis : sans un coup de feu, ils se rendent maîtres du petit village et de 30 soldats des groupes mobiles de réserve surpris dans leur sommeil : ils obtiennent la promesse que le prisonnier sera libéré. Le 8 mars, ils repoussent plusieurs attaques de la Milice.
Tout Annecy est au courant ; la population est de cœur avec eux. Les gendarmes locaux et une partie des gardes mobiles ne demandent qu’à fermer les yeux. Cependant, la répression se durcit. Darnand vient à Annecy du 16 au 18 février ; il rappelle à l’ordre l’intendant de police Lelong qui prétendait ne pas se laisser dicter sa conduite par les miliciens. Le 20 février, la cour martiale d’Annecy condamne sept hommes à mort et celle de Thonon cinq qui sont aussitôt exécutés. Cinq autres le sont à Annecy le 6 mars ; ils tombent sous les balles françaises en chantant La Marseillaise.
Le 9 mars, Tom Morel tente l’opération la plus hardie. Le médecin du maquis, capturé par les forces de l’ordre, n’a pas été libéré, contrairement aux promesses ; cinq autres maquisards ont été faits prisonniers sur une route que les autorités de police s’étaient engagées à laisser libre. Tom Morel organise une descente en force sur Entremont. I s’agit d’enlever par surprise les différents postes de GMR pour prendre quelques otages afin de recouvrer les prisonniers en échange. Tom a dit : « je ne veux pas d’effusion de sang ». Mais dans la nuit, des chiens donnent l’alarme. La fusillade éclate dans le village. Les maquisards s’emparent de vive force des deux hôtels où les GMR sont cantonnés et les font prisonniers, y compris leur commandant. Soudain, le succès tourne au drame. Le commandant de GMR a demandé à garder son arme ou a caché une arme. Il tire à bout portant sur Morel : celui-ci s’effondre, tué d’une bale dans le cœur. L’officier de police est à son tour abattu. Soixante GMR prisonniers sont conduits sur le plateau, en même temps que la dépouille du lieutenant Morel. Nous contemplons toujours avec la même émotion les photos de la chapelle ardente où Tom repose sous un drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine, les images du cortège funèbre du jeune chef héroïque auquel ses compagnons d’armes rendent les honneurs, en présence de ses parents qui auront réussi à monter au plateau.
La nuit qui suit la mort de Morel, celle du 10 au 11 mars 1944, a lie le plus important parachutage. 34 bombardiers se sont envolés de Londres, 14 vers La Plagne, 20 vers Glières ; parmi ceux-ci, 9 Libertadors, les tout nouveaux quadrimoteurs que les Américains mettent à la disposition de la RAF, et 11 Stirlings. La BBC a diffusé la phrase code : « Le petit homme aime le Byrrh ». Quatre grands bûchers jalonnent le plateau : 17 avions parviennent au but et lâchent leur charge. Les containers de 150 kilos s’enfoncent dans la neige profonde. La tradition locale fait état de 584 cylindres, soit 90 tonnes de matériel, chiffre très supérieur à celui qu’on peut déduire des registres tenus à Londres, selon lesquels la charge était inférieure à 50 tonnes et plus probablement voisine de 40 [15]. La masse dépasse en tout cas, les moyens d’évacuation. Il faut plusieurs jours de recherche et d’effort pour tout récupérer.
La disparition de Morel cause un profond désarroi. Le lieutenant Joubert assume le commandement par intérim et les maquisards gardent la maîtrise des opérations : le 11 mars, ils repoussent une attaque des GMR sur Notre-Dame-des-Neiges et en capturent 10, ce qui porte le total de leurs prisonniers à 70. Le 12, 120 hommes des maquis du Giffre et du Chablais montent sur le plateau ù l’effectif approche maintenant de 500 hommes. Le 20 mars, la milice qui attaque sur plusieurs points, sous couvert de tirs de mortiers, est rejetée avec de lourdes pertes.
Entre temps, Glières a accueilli un nouveau chef dont le nom est inséparable de la dernière phase des combats, le capitaine Anjot. Plus âgé que Morel – 40 ans –, officier d’expérience, froid et réfléchi, instructeur à Saint-Cyr pendant six ans, il s’est mis, dès 1941, au service de la Résistance et il a été en 1943, aux côtés de Vallette d’Osia, l’artisan de l’Armée secrète en Haute-Savoie. Il a participé à des coups de mains, l’arme au poing. Il est l’adjoint du commandant Clair, chef de l’AS de Haute-Savoie. Cet homme méthodique est un homme de conscience et de foi. Le 15 mars, il accepte le commandement des Glières. Il semble bien qu’il l’ait sollicité. La lettre qu’il lasse à sa femme dit bien dans quel esprit :
« Nombreux sont ceux qui, par des raisonnements plus ou moins faux et lâches, se détournent du devoir national. En tat qu’officiers, je ne puis le faire [16] ».
Il a conscience d’assumer une mission de sacrifice. Il monte au plateau en emportant sa vareuse d’officier de chasseurs et le drapeau dont il avait la défense en 1940 : car s’il doit mourir, il tient à « mourir Anjot ». Il prend sont commandement le 18 mars, devant tous les hommes rassemblés, sauf ceux qui sont aux postes de garde. Il demande : « « Voilà, je prends le commandement. Est-ce que vous voulez de moi ? ».
Mais c’est déjà le commencement de la fin. Depuis trois semaines, les Allemands ont avisé les autorités de Vichy que les opérations devaient être terminées le 10 mars, sinon ils prendraient les choses en main.
Une question se pose ici, toujours lancinante après 50 ans : pourquoi les maquisards des Glières n’ont-ils pas décroché, comme Koenig a su le faire à Bir Hakeim, sans attendre que l’encerclement soit infranchissable et que la fonte des neiges ouvre la voie aux Allemands ? la question a donné lieu à polémiques : on se souviendra qu’après la guerre, le parti communiste imputa à l’état-major de la France Combattante la responsabilité d’un maintien délibéré sur place dénoncé comme criminel.
De gaulle étant à l’époque à Alger, les correspondants extérieurs du maquis savoyard étaient mes services français et anglais de Londres, BCRA et SOE. Disons tout de suite que jamais ceux-ci n’ont prescrit de tenir Glières jusqu’à s’y faire tuer sur place. Les services anglais ont toujours déclaré qu’ils n’armaient pas les maquis pour faire une guerre statique selon les principes traditionnels. Côté français, le porte-parole Maurice Schumann a rappelé deux fois la consigne de mobilité et il semble bien que le BCRA, lorsqu’il perçut l’aggravation du danger, le 21 mars, ait lancé un télégramme de mise en garde. La décision de tenir a donc été prise sur place.
Cela étant, il faut voir combien la liaison entre maquis et bureaux de la France Libre est aléatoire et prêt aux malentendus ou, du moins, aux interprétations douteuses.
Les télégrammes de Savoie reçus à Londres sont décryptés les uns par les services français, les autres par les services anglais, avec un délai de un à six, voire huit jours. De plus, trois facteurs d’incertitude obèrent les décisions.
1°) Une situation militaire telle que celle des Glières, je veux dire le passage à l’action ouverte, est sans précédent pour les équipes londoniennes. La doctrine de la guérilla n’est pas impérativement définie. Les Anglais et les meilleurs experts français récusent la notion de « réduit », mais elle fascine beaucoup d’entre nous, comme elle fascine – les Anglais s’en plaignent – beaucoup d’officiers supérieurs de l’ancienne armée d’armistice. On la rejette en principe, mais on admet qu’après le débarquement puisse se constituer au Vercors quelque chose qui ressemble beaucoup à un « réduit ». En réalité, la montée en puissance de la Résistance militaire se fait dans l’improvisation. Il faudra attendre avril pour que soit constitué autour de Koenig un état-major FFI et la mi-mai pour que de Gaulle signe l’instruction sur les opérations en France.
2°) le dossier Glières révèle un malentendu quant à l’intervention éventuelle d’unités de parachutistes pour soutenir les maquis. Cantinier et l’état-major clandestin ont demandé plusieurs fois une telle intervention ; Emmanuel d’Astier et son frère, le général de corps d’armée aérien François d’Astier ont appuyé la demande. Le 15 mars encore, Bourgès-Maunoury télégraphiait à Londres que Glières pouvait « recevoir tous les effectifs ». Cantinier implorait encore Londres le 22 mars, puis le 27 au matin, d’envoyer un bataillon de paratroupes. Or, dès la mi-février, l’état-major allié avait écarté cette éventualité, de même qu’il écartait la possibilité de faire intervenir la RAF contre les concentrations allemandes dans la vallée des Alpes. Mais ces impossibilités n’ont jamais été signifiées aux délégués militaires sur le terrain, et elles ne pouvaient pas l’être.
3°) troisième élément d’incertitude, les responsables français ignorent la date du débarquement. A la mi-février, les services anglais ont précisé qu’il ne fallait pas donner à croire que le débarquement était imminent. Mais ces mêmes services interdisent qu’on télégraphie en France une telle information. Le débarquement, les Français l’espèrent de jour en jour ; en février-mars 1944, le front allemand de l’Est s’écroule, les Soviétiques atteignent la frontière polonaise. Peut-on faire grief à des chefs qui, sur le terrain, ont cru le débarquement tout proche, à ceux qui, comme Cantinier me l’a dit, ont cru Glières en mesure de résister jusqu’au débarquement aux forces de Vichy ?
Deux facteurs ont prolongé l’occupation de Glières jusqu’à l’irrémédiable.
L’un est la fascination des armes parachutées. Les maquisards en sont devenus prisonniers. Comment abandonner sans combat les tonnes de matériel reçues le 11 mars ? Et comment justifier vis-à-vis des Alliés un tel abandon ? Qui plus est, un nouveau parachutage est attendu, car ce même 11 mars, Londres a spontanément annoncé pour le 17 une seconde opération de 20 avions, annulée on ne sait pourquoi à la dernière minute. Cantinier avait demandé qu’elle apporte des mitrailleuses de DCA et des engins antichars en vue, avait-il télégraphié « d’une opération que j’exposerai [dans un] prochain câble ». La phrase convenue pour annoncer ce nouveau parachutage était : « Michette a la rougeole [17] ».
Il ne semble pas que Londres ait perçu la gravité de la situation avant le 21 mars. Le 17, le commandant Descours, responsable militaire clandestin de la région R1, a averti que la situation due à la répression en Haute-Savoie devenait bon de demander autre chose qu’un appui radiophonique. Aussi le 20 mars, Londres laisse prévoir un parachutage de 6 avions porteurs de 90 containers largement pourvus de vivres : comment ne pas y voir la promesse d’un soutien résolu ? De part et d’autre, on attend du partenaire plus qu’il ne peut donner.
Une seconde raison concourt à ne pas évacuer Glières : c’est que les défenseurs ont pris conscience d’assumer une mission qui dépasse le cadre local. La propagande radio y a sans aucun doute contribué. Il n’y a guère de jour où la BBC n’affirme que les maquis sont l’honneur de la France. Cette publicité, Cantinier l’alimente. Pour lui, affirme un témoin, l’action de guérilla, de sabotage, n’était pas suffisante [18] :
« Il fallait fournir à Londres la preuve que la Résistance ne s’exprimait pas seulement en paroles, mais par les faits, qu’elle représentait une force considérable avec laquelle les Allemands devaient compter ».
Le 2 mars, exalté par les premiers succès de Morel, il a télégraphié à Londres [19] :
« Nous vous demandons de nous aider et de dire aux Alliés de la France que nous sommes fiers de pouvoir nous battre, de pouvoir incarner la Résistance, que nous sommes heureux d’être le symbole du pays qui refuse de se soumettre. Nous sommes l’avant-garde du combat qui nous rendra nos libertés ».
Journellement, il rend compte. Il télégraphie parfois nommément à Schumann les informations à diffuser, les hauts faits à magnifier. Il ne cessera de le faire.
Il y a plus. Le 9 mars, avant le coup de main sur Entremont, il est monté au plateau. Il a exposé devant Morel que Glières devait être considéré comme une tête de pont pour le débarquement allié qui ne devait pas tarder. Il l’a redit après la mort de Tom, au cours d’une réunion décisive tenue à Annecy le 15 ou le 16 mars. Les responsables de Glières se sentent désormais tenus de prouver aux Alliés que la Résistance militaire existe et qu’ils sont prêts à jouer leur part dans les opérations du débarquement attendu.
En ce mois de mars 1944, pour nous, de la France Libre, et j’imagine aussi pour Cantinier, Morel et Anjot, Glières égale Bir Hakeim. Le 21 mars, les Glières prennent place dans la légende dorée a même titre que Bir Hakeim dans l’hommage que Schumann rend aux maquis de Haute-Savoie, au chef du groupe franc Simon, et d’abord à Morel : « Il s’appelait Tom. IL était officier d’active, ancien instructeur à Saint-Cyr… ».
Lorsque le capitaine Anjot monte aux Glières, il sait quel est le sens et l’enjeu de l’affrontement engagé sur ce premier lambeau de terre libérée. Peut-être a-t-il en mémoire le message que le général de Gaulle adressait à Koenig au dernier jour de Bir-Hakeim : « Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil ». Il juge l’issue sans espoir, mais il juge aussi « l’évacuation psychologiquement impossible ». Si soucieux qu’il soit du sort de ses hommes, il se sent investi d’une responsabilité plus lourde, qui est de témoigner. Quand on lui suggère d’évacuer, il répond : « Je continue ».
Depuis le 8 mars, des avions de reconnaissance allemands survolent le plateau ; le 12, le 17, le 23, l’aviation allemande le bombarde ou le mitraille. Le 20 mars, le général Pflaum, commandant la 157e division alpine allemande vient prendre contact avec les chefs de la milice : on se répartit les rôles. Les forces allemandes – vraisemblablement 6 à 7 000 hommes avec de l’artillerie de montagne – prennent position les 22 et 23 mars tandis que la milice complète le bouclage. La fonte des neiges rend le plateau accessible : 460 homes ne pourront pas tenir une telle surface.
Jusqu’au bout, les autorités de Vichy ont souhaité éviter l’affrontement et surtout l’intervention armée des Allemands ; elles constatent leur impuissance. La gendarmerie et la garde mobile, trop peu sûres, ont dû être retirées. La milice continue d’être partout repoussée. « Nous ne sommes pas des bourreaux », avait assuré l’intendant de police d’Annecy en février ; et des intermédiaires bien intentionnés avaient fait suggérer à Morel d’évacuer momentanément le plateau : il s’y était refusé. Le 23 mars, les chefs miliciens à leur tour envoient des émissaires pour obtenir la reddition de Glières : « on » serait prêt à distinguer entre les réfractaires au passé honnête et les « terroristes » qui seraient livrés à la justice.
La réponse que fait porter Anjot est claire [20] :
« Il est regrettable que des Français tels que vous l’avez été fassent en ce moment le jeu de l’ennemi. Quant à moi, j’ai reçu une mission : il ne m’appartient pas de parlementer ».
Le 25 mars, Darnand est sur le terrain. Lui qui a prêté double serment à Pétain et à Hitler ne s’embarrasse pas de scrupules : c’est avec le concours de ce ministre français et de ses tueurs que l’armée allemande montera à l’assaut.
L’opération est prévue pour le mardi 28 mars [21]. A partir du 24, de sévères bombardements d’artillerie, puis deux bombardements aériens détruisent le PC d’Anjot et incendient la plupart des chalets. Le dimanche 26 mars, le commandement local allemand croit comprendre, d’après le témoignage intercepté, qu’un décrochement général a commencé, ce qui permettrait au gros de la troupe d’échapper à l’écrasement. Il brusque les choses. Les miliciens qui ont démarré les premiers ont été encore une fois repoussés. L’infanterie allemande en survêtements blancs attaque l’après-midi ; l’assaut se concentre vers le hameau de Monthiévret où convergent deux sentiers venant des vallées. Les postes de défense résistent mais sont tournés. Ils finissent par succomber. L’accès au plateau est ouvert. Cependant la nuit tombe. Les Allemands n’exploitent pas leur avantage et remettent l’assaut général au lendemain. Le silence revient. A 22 heures, Anjot se concerte avec son petit état-major. Tout lui donne à penser que les Allemands ont pris pied sur le plateau. Se maintenir à un contre dix serait voué ses hommes au massacre. « Je crois pouvoir affirmer que l’honneur est sauf », dit-il. Il adresse aux sections l’ordre écrit de rejoindre les vallées où elles se disperseront pour traverser les barrages et regagner les maquis d’origine.
Le drame ne fait pourtant que commencer. Les pertes des maquis sont encore relativement faibles et l’on ignore les pertes allemandes, sans doute légères ; les archives de la 157e division n’en font pas mention. Les groupes descendent dans la nuit avec parfois de la neige jusqu’au ventre. Mais dans les vallées, la circulation est interdite. Près du Petit-Bornand, il y a des barrages tous les 200 mètres. C’est pendant quatre jours la chasse à l’homme. Allemands et miliciens s’en donnent à cœur joie. L’après-midi du 27, Anjot tombe dans une embuscade près de Naves : on retrouvera son corps avec cinq autres, alignés face à la montagne, avec des impacts de balles dans le dos.
Embuscades et fusillades un peu partout. Le lieutenant de Griffolet d’Aurimont et deux de ses camarades sont abattus à Thorens par la milice. Les exécutions sommaires se poursuivront tout avril. Les prisonniers épargnés sont entassés à Annecy au quartier Dessaix. Le lieutenant Lalande qui s’est réfugié dans le Midi croit de son devoir de revenir fin avril ; reconnu, les miliciens te torturent affreusement avant de le livrer aux Allemands qui l’exécutent en même temps que l’aspirant Bastian. Le 4 mai, la cour martiale d’Annecy condamne à mort neuf jeunes hommes désignés comme soi-disant chefs du maquis : 5 sont aussitôt fusillés. Le bilan final sera lourd : outre les armes perdues, l’organisation démantelée, l’espoir momentanément brisé, on comptera 149 morts abattus, fusillés, torturés à mort ou disparu en déportation, non compris les victimes dans la population civile. Philippe Henriot fait des émissions atroces : il dénonce « un ramassis de déserteurs et de gamins », « ces visages où l’on retrouverait les plus sinistres photos des brigades internationales », « tous ces hommes lâchés par leurs chefs… La légende est morte. L’Armée secrète est en fuite. Bayard a fui… ». Bayart, c’est Anjot. Une telle calomnie devant un tel sacrifice donne la mesure d’Henriot. Il mettra dix jours avant d’oser parler – et en quels termes – du « cyrard Morel ». Pas un journal, pas une émission de Vichy ou de Paris ne révèlera que c’est l’armée allemande qui a achevé Glières.
« Glières a été une défaite des armes, mais une victoire des âmes », m’écrivait Romans-Petit. Défaite des armes, oui. ¨Pourtant, grâce à l’ordre d’Anjot, 300 hommes auront réchappé, proportion supérieure à celle des rescapés de Bir Hakeim. Et sitôt es forces de maintien de l’ordre retirées, la résistance de Haute-Savoie renaît de ses cendres. La chute de Glières n’aura été qu’un épisode dans une lutte qui se poursuit et s’amplifie. Un mois plus tard, le 2 mai, les maquisards de Jourdan, le seul officier survivant, montent faire une manœuvre au plateau. Et le 1er août 1944, preuve que le choix du site était bon, un des parachutages les plus spectaculaires de la guerre sera reçu aux Glières en plein jour par 2 500 FFI. Trois semaines plus tard, la Haute-Savoie sera libérée.
Victoire des âmes, oui. A deux mois du débarquement allié, Schumann et le Suisse René Payot peuvent attester que des patriotes menés par des officiers d’active ont livré la première bataille ouverte à l’Allemand sur le sol national. Le milicien Philippe Henriot s’emploiera en vain à déconsidérer et à isoler la Résistance ; le maréchal Pétain adjurera en vain les Français de ne pas participer aux combats. Exalter l’honneur et le courage par l’exemple des héros des Glières, ce sera préparer les Français à participer à leur libération. Le porte-parole de la France Combattante pourra s’écrier, le 11 avril : « Allo ! Ceux des Glières, merci ! » et évoquer le 14 juillet de la Victoire, où « le drapeau du 27e BCA portera sous l’Arc de Triomphe, enfermés dans ses plis, le sang, la gloire et le nom des Glières ». Les Alliés auront retenu la leçon des Glières en déversant entre avril et mai 1944, 16 000 containers et colis d’armes sur la France. Quant aux Allemands, ils sauront que des unités d’une armée régulière peuvent surgir sur notre sol.
Près cinquante ans, Glières reste un des meilleurs témoignages que les Français aient pu donner de leur dignité. Morel, Anjot, Cantinier et leurs camarades ont voulu témoigner pour l’honneur. De Gaule nous l’avait enseigné, cette guerre avait pour double enjeu la libération de notre sol et l’image que la France garderait d’elle-même. Les martyrs des Glières sont morts pour notre fierté. Au seuil d’un nouveau millénaire incertain, disons qu’ils sont morts pour la toujours jeune espérance.
[1] Cf. Les Voix de la Liberté, Paris, La Documentation Française, 1975, T.4, où sont reproduites les principales émissions consacrées par la BBC aux Glières.
[2] AN, 72 AJ/188/1, traduction de BOB. 56 déb., OKW 29.
[3] Cf. Louis JOURDAN, Julien HELFGOTT, Pierre GOLLIET, Glières, Première bataille de la Résistance, Annecy, Association des Rescapés, 1968, p. 38.
[4] Lettre à l’auteur du 17.09. 1970.
[5] AN, 3AG2/401.
[6] Lettre de Gaulle à Churchill, 10.03.1943. De Gaulle, Lettres, notes et carnets 1941-1943, pp. 534-535.
[7] PRO, CAB 80/68, COS. (43) 142(0) ; CAB 79/26, COS (43) 48th Meeting (0), Minute 6, Fol. 188-190.
[8] SHAT, 237/K2.
[9] AN, 3 AG2/523.
[10] Ibid.
[11] Cf. rapport Polygone (Bourgès-Maunoury) du 5.2.44, AN, 3 AG2/229 et le télégramme commun Losange (Mangin) – Apothème (Rosenthal) du 2.2.44, AN, 3 AG2/523.
[12] SHAT, 237 K/2.
[13] AN, Fla/3816.
[14] AN, 3 AG2/524.
[15] La charge utile des avions était de 68 tonnes et leur capacité maximum de 336 containers, chiffre sans doute réduit à 270, sinon 204 pour raisons de sécurité ; s’y ajoutaient des « colis » de 55 kilos, au nombre probable de 100 à 150.
[16] Claude ANTOINE, Un village dans la bataille des Glières. Capitaine Anjot : l’honneur d’un chasseur alpin, Association des rescapés des Glières, Meythet, 1992, p.23.
[17] AN, 3 AG2/98.
[18] Témoignage de Guidollet, chef départemental des MURS.
[19] AN, 3 AG2/524.
[20] Ibid., p.41.
[21] Sur l’intervention allemande, les combats du 26 mars, « la traque » et la répression ultérieure, cf. l’ouvrage définitif de Michel GERMAIN, Glières, mars 1944, Les Marches, La Fontaine de Siloé, 1994, pp.148-282.