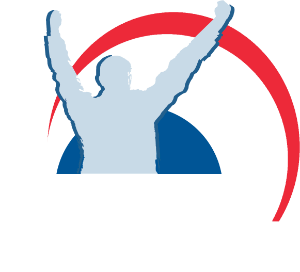La scène se passe le 25 août 1944 à l’Hôtel de Ville de Paris. C’est une journée historique, celle de la Libération de la capitale après quatre longues et douloureuses années d’occupation allemande. Arrivés par la Porte d’Orléans, les soldats de la deuxième DB du général Leclerc ont obtenu la capitulation des troupes allemandes du général von Choltitz, gouverneur militaire de Paris.
Partout dans la ville, l’atmosphère est à la liesse populaire mêlée toutefois de crainte car les combats sporadiques se poursuivent ici ou là. De retour dans la capitale, le général de Gaulle s’installe à l’hôtel de Brienne, au ministère de la Guerre, puis se rend dans la soirée à l’Hôtel de Ville où, quelques mois plus tôt, le 26 avril 1944, le maréchal Pétain avait été acclamé par la foule.
Comme souvent dans les heures décisives pour notre pays, le chef de la France Libre prononce un discours pour l’Histoire. « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. »
Au milieu de l’assistance masculine qui entoure le chef de la France Libre, se détache une jeune femme jolie et élégante, coiffée d’un petit chapeau rond. Elle écoute avec passion ce discours. Elle sait qu’elle est en train de vivre un moment historique. À un moment, submergée par l’émotion, elle écrase discrètement une larme. Cette jeune femme à qui les organisations de la Résistance ont confié la charge de remettre au Général le bouquet de fleurs de la victoire, porte un nom pas encore célèbre : c’est Brigitte Servan-Schreiber, qui deviendra Brigitte Gros, future maire de Meulan et sénatrice des Yvelines.
Née le 12 juin 1925 à Saint-Germain-en-Laye, elle est la deuxième des cinq enfants et l’aînée des trois filles d’Emile Servan-Schreiber, industriel et patron du journal économique Les Échos, et de Denise Brésard. Elle est la sœur de Jean-Jacques Servan-Schreiber, JJSS, fondateur de L’Express et grande figure de la presse et de la politique de la deuxième moitié du XXe siècle.
Pendant la guerre, la jeune Brigitte entre dans la Résistance à seulement 18 ans, comme agent de liaison dans les maquis de l’Ain, sous les ordres du gaulliste Léo Hamon. Arrêtée à la gare de Melun, en Seine-et-Marne, le 15 août 1944, torturée par la Gestapo, elle doit sa liberté et sans doute sa vie à la bienveillance d’un officier allemand qui a eu pitié de sa jeunesse. Dans « Louise et Juliette », histoire romancée de sa famille sous l’Occupation, Catherine Servan-Schreiber, fille de Brigitte Gros raconte la scène en donnant la parole à sa mère : « Un Allemand a ouvert la porte de ma cellule en me disant de partir vite… Il me trouvait trop jeune pour mourir ! »
Pendant les journées d’insurrection populaire qui précèdent la Libération de Paris, Brigitte, sa mère et ses deux sœurs – Christiane Collange et Bernadette Gradis – se rendent à l’Hôtel de Ville tenu par les FFI, les Forces françaises de l’intérieur, pour y donner un coup de main. « Les hommes se battaient et les femmes s’occupaient de l’intendance », notamment à l’infirmerie, raconte Catherine Servan-Schreiber qui décrit le moment où sa mère a remis le bouquet de fleurs à de Gaulle : « Dans un moment d’intense exaltation, tous retenaient leur souffle, les regards accrochés à la progression lente et solitaire de la jeune fille au milieu de la foule qui s’était écartée. Le bruit de ses semelles de bois claquait sur le parquet. » « Son visage, poursuit-elle, était contracté pour essayer de maîtriser son intense émotion et ses lèvres tremblaient. Le Général se découvrit la tête, se pencha vers (la jeune femme) pour l’embrasser et saisir les fleurs. Avec ses gants blancs, au coin de ses yeux, elle essuya des larmes de joie. »
Après cette journée mémorable, Brigitte Servan-Schreiber suit la Première armée du général de Lattre de Tassigny et participe à la campagne d’Alsace. Son courage lui vaut la croix de guerre avec la citation suivante signée du colonel André Demetz : « Toujours volontaire pour les missions périlleuses. Elle a donné l’exemple du plus pur courage. »
Après-guerre, elle embrasse une carrière de journaliste. Ses sujets de prédilection, les questions d’urbanisme, de transport et d’équipement. Elle travaille aux Échos le journal de sa famille, puis pour le quotidien Paris-Presse-l’Intransigeant avant de participer à la grande aventure de L’Express, créé par son frère aîné Jean-Jacques et par Françoise Giroud.
Mais Brigitte Gros n’a pas vraiment le feu sacré. « Heureusement la vie ne fait pas que s’écrire, et Brigitte a de l’énergie à revendre. Partout où elle va, les gens sont frappés par une gaieté, un aplomb, un enthousiasme qu’expriment un joli corps épanoui et un visage bien dessiné où brillent des yeux bleus », écrivent Alain Rustenholz et Sandrine Treiner, auteurs du livre « La Saga Servan-Schreiber ». « Elle accompagne souvent son frère aîné. La complicité enfantine de Jean-Jacques avec sa sœur ne s’est pas évanouie avec l’âge », ajoutent-ils. « Elle et lui séduisent ensemble, chacun avec ses atouts propres. »
JJSS et Brigitte Gros – elle s’est entre-temps mariée avec Emeric Grosz, un riche maroquinier d’origine hongroise – fréquentent alors les cercles du Parti radical, Edgar Faure et surtout Pierre Mendes France. Bientôt elle se lance dans une carrière politique, dans le sillage de JJSS, au Parti radical puis au Mouvement réformateur. Au centre gauche, loin, très loin du gaullisme. « Au fond c’est peut-être elle la vraie politicienne de la famille », observent Rustenholz et Treiner. Élue en 1965 conseillère municipale de Meulan, dans les Yvelines, elle devient maire l’année suivante et le restera jusqu’à sa mort en 1985. Sous son mandat, la ville se modernise et voit sa population doubler.
En 1970, forte de son expérience municipale, Brigitte Gros publie un livre « Quatre heures de transport par jour », dans lequel elle évoque les galères des banlieusards. Cet ouvrage sera adapté au cinéma en 1973 par Gérard Pirès, avec Marthe Keller et Jacques Higelin, sur un scénario de Nicole de Buron. Dans « Les Paradisiennes », la maire de Meulan décrit la vie des femmes dans les grands ensembles qui se multiplient alors en région parisienne, et qui, écrit-elle, vivent « comme des taupes dans leur trou ».
Conseillère générale d’Aubergenville, de 1967 à 1973, Brigitte Gros entre au Sénat en 1973 et y siégera jusqu’à son décès. On retrouve dans son action parlementaire, les thèmes qui la passionnent : la rénovation urbaine, les transports. Mais aussi la cause des femmes. Elle dépose plusieurs propositions de loi visant à mieux protéger les femmes contre le viol en assurant une plus grande publicité des condamnations des violeurs ; à améliorer les modes de garde des jeunes enfants ; à faciliter l’accès des femmes à la vie publique.
À sa mort en 1985, à seulement 59 ans, le président du Sénat Alain Poher rend hommage à Brigitte Gros en évoquant « son éloquence persuasive et son extraordinaire puissance de travail » mises au service d’un « message pour un mieux-vivre des populations, pour le respect des libertés, pour plus de justice ».